
L’incrédulité de Thomas. Le Caravage, 1601.
Huile sur toile, 118 x 156,5 cm. Collection privée, Florence (Wikipédia).
Il faut le voir pour le croire !
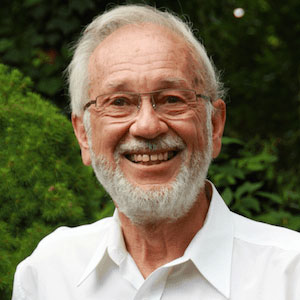 Paul-André Giguère | 2e dimanche de Pâques (B) – 7 avril 2024
Paul-André Giguère | 2e dimanche de Pâques (B) – 7 avril 2024
Jésus apparaît à ses disciples : Jean 20, 19-31
Les lectures : Actes 4, 32-35 ; Psaume 117 (118) ; 1 Jean 5, 1-6
Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.
« Nous avons vu le Seigneur! », s’écrient, excités, les disciples à Thomas qui « n’était pas avec eux quand Jésus était venu » (Jn 20,24-25). On connaît la réaction de ce jumeau qui était ailleurs : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, non, je ne croirai pas! » Cette parole a conféré à Thomas la réputation peu enviable, qui a traversé les siècles, d’être « l’homme qui doute ». Vu de même, comme on dit, la parole que le Ressuscité lui aurait adressée huit jours plus tard prend l’allure d’un reproche : « Parce que tu m’as vu, tu crois ; heureux ceux qui croient sans avoir vu » (v. 29).
On a ainsi fait de Thomas le symbole commode de tous ceux et celles qui ayant des doutes et demandant de « voir », se rendraient ainsi coupables de manquer de foi. Que de tourments intérieurs ont vécu et vivent toujours les personnes qui se posent des questions à propos de la foi et qui, pour le moment, habitées par le doute, n’arrivent pas à croire comme il faudrait.
Pourtant, quelques lignes plus haut, le même évangéliste n’avait-il pas dit de Jean, accouru avec Pierre au tombeau : « Il vit et il crut » (20,8)? De son côté, Matthieu ne se gêne pas pour souligner que « quand ils le virent (le Ressuscité), ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes » (28,17). La question se pose : pourquoi donc y en a-t-il un qui a cru après avoir vu et qui ne fait l’objet d’aucun reproche, et d’autres qui doutent et qui ne sont par repris non plus? N’y aurait-il pas méprise sur l’épisode de Thomas?
Doute et soupçon
Le sociologue Frédéric de Koninck distingue utilement le soupçon, qu’il présente comme une attitude de défiance systématique, du doute comme attitude qui pousse à de plus amples investigations [1]. N’est-ce pas ce dont il s’agit ici? Thomas ne doute pas pour douter. Il doute en vue de croire. Il n’est pas dans l’emballement qui semble avoir saisi les autres disciples (« Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur » - v. 20).
La santé du doute de Thomas en cheminement vers la foi me fait penser à cette confidence du pape François : « Si quelqu’un dit qu’il a rencontré Dieu avec une totale certitude et qu’il n’y a aucune marge d’incertitude, c’est que quelque chose ne va pas. C’est pour moi une clé importante. Si quelqu’un a la réponse à toutes les questions, c’est la preuve que Dieu n’est pas avec lui, que c’est un faux prophète qui utilise la religion à son profit. Les grands guides du peuple de Dieu, comme Moïse, ont toujours laissé un espace au doute [2]. »
Le doute dans le domaine de la foi est, me semble-t-il, une étape vers une foi plus pure. Les mots de la foi risquent toujours de délimiter et de clore le mystère, de l’enfermer dans des formules. Le doute, c’est l’espace qui doit rester ouvert. « Ce qui ne permet pas le doute ne respecte pas non plus l’inachevé du mystère en nous [3] ».
Le témoignage de ceux qui ont vu
Ne faut-il pas s’enlever de la tête l’idée que ceux qui ont « vu » Jésus de son vivant, et le nombre encore plus restreint de ceux qui ont « vu » le Christ ressuscité, sont par rapport à nous des privilégiés? On n’observe pas, dans l’Église primitive, qu’ils aient formé une caste supérieure, une catégorie à part des autres. On observe cependant qu’ils sont devenus des témoins. Des témoins de ce qu’ils ont vu. « Si nous vous avons fait connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus Christ, c’est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur », écrit l’auteur de la Deuxième lettre de Pierre (1,16). Dans le prologue de son évangile, Luc insiste aussi pour faire remonter sa source à « ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole » (1,2). Le témoignage le plus éloquent est certes celui de Jean au début de sa première lettre : « Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. » (1,1.3)
Ces témoins de la foi parlaient et écrivaient depuis ce qu’ils avaient vu et entendu. Mais désormais, comme l’écrit Paul, « la foi vient de ce que l’on entend, et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ » (Romains 10,17). N’est-ce pas précisément ce dont il s’agit avec les deux autres lectures bibliques de ce dimanche?
La deuxième lecture nous montre comment le témoignage de ceux qui ont vu élabore un discours qui va bien au-delà de la narration primitive. La Bonne nouvelle est annoncée de manière très dense dans cet extrait de la première lettre de Jean qui décrit l’état dans lequel fait entrer la foi. Le chrétien est « né de Dieu » (trois mentions), il est donc son enfant. Le chrétien vit de l’amour que Dieu lui porte et dans l’amour qu’il a pour « le Père » et pour « les enfants de Dieu ». Mais ces convictions prennent racine dans le témoignage rendu depuis des décennies, à savoir que l’homme Jésus est « le Christ », le « Fils de Dieu », qui est « venu par l’eau et par le sang ». Ainsi ce témoignage qui était d’abord raconté commence à devenir théologie et amorce de dogme.
Si la lettre de Jean témoigne par le discours, dans la première lecture nous avons affaire au témoignage des premiers chrétiens par leur manière de vivre. Je suis frappé de ce que le texte de ce « sommaire » parle de « puissance » à propos du témoignage et d’« abondance » à propos de la grâce. Sans doute le partage des biens au sein de la communauté, qui s’est perpétué dans la longue histoire de la vie religieuse, a-t-il pris par la suite plusieurs autres formes jusqu’à aujourd’hui. Luc insiste pour mettre en relief cet effort de cohérence que la première communauté cherchait à établir entre ce qu’elle croyait et sa manière de vivre.
Au fil des siècles, ce ne fut tristement pas toujours le cas, et à ce sujet on connaît les paroles attribuées au Mahatma Gandhi : « Sans doute serais-je chrétien si les chrétiens l’étaient vingt-quatre heures par jour. Si tous les chrétiens agissaient comme le Christ, le monde entier serait chrétien. »
Le monde a besoin de « voir » pour pouvoir croire. Il a besoin de voir des témoins crédibles. Et cette crédibilité ne peut venir que d’une authentique expérience intérieure de ce dont parle Jean dans la deuxième lecture : la vie en Dieu, la vie vécue dans l’amour du Père et dans l’amour des autres. Nous ne sommes pas de ceux qui voient, mais de ceux qui, en raison de ce que nous vivons par l’intérieur, sont renouvelés ou, comme le dit l’épître, « nés de Dieu » et témoignent de cette vie nouvelle.
Car nous avons toujours devant nous et en nous la figure de Jésus-Christ. « Lui, vous l’aimez sans l’avoir vu ; en lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. » (1 P 1,8)
Diplômé en études bibliques et en andragogie, Paul-André Giguère est professeur retraité de l’Institut de pastoral des Dominicains (Montréal).
[1] Frédéric De Koninck, « Le soupçon et le doute », Regards protestants.
[2] François. Interview accordé à la Civiltà cattolica et autres revues culturelles jésuites, dans Études, octobre 2013, p. 21-22.
[3] Simon Pierre Arnold, La foi sauvage. Bilan provisoire d’un théologien perplexe, Paris, Karthala, 2011, p. 64.
Source : Le Feuillet biblique, no 2841. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation du Diocèse de Montréal.
