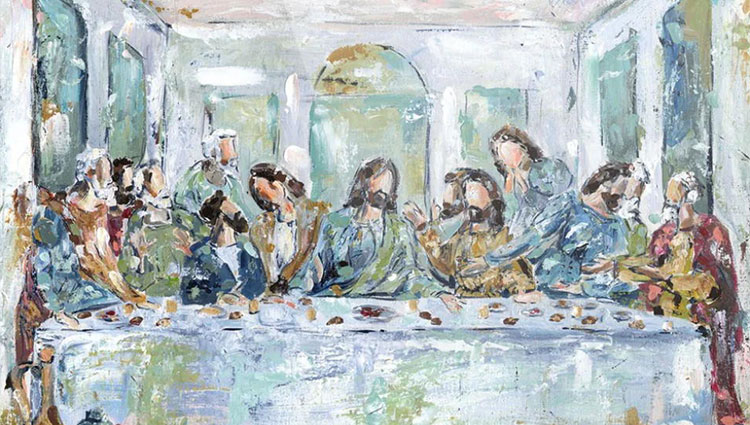
Dernière Cène. © Chelsea McShane, 2019. Acrylique sur toile, 70 x 45 cm (image : courtoisie de l’artiste).
« Ceci est mon corps, ceci est mon sang »
 Odette Mainville | Saint Sacrement (B) – 2 juin 2024
Odette Mainville | Saint Sacrement (B) – 2 juin 2024
Institution de l’Eucharistie : Marc 14, 12-16.22-26
Les lectures : Exode 24, 3-8 ; Psaume 115 (116B) ; Hébreux 9, 11-15
Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.
Le texte évangélique selon Marc (14,12-16.22-26) fait écho à un moment fort important de la tradition juive, en l’occurrence, celui de la célébration de la Pâque. Cette fête commémore la sortie d’Égypte du peuple hébreu, jour de délivrance qui marque le début de la longue histoire de ce peuple. Chaque année, des Juifs de Palestine, mais aussi de la diaspora, se rendaient en pèlerinage à Jérusalem, afin de célébrer la Pâque ; cérémonie au cours de laquelle on immolait un agneau que l’on mangeait avec du pain sans levain.
Jésus et ses disciples participeront donc, eux aussi, à cette fête traditionnelle. Mais Jésus, sachant que sa fin approche, conférera un sens nouveau à la célébration au cours de son dernier repas avec eux. Un sens qui, à la fois, s’inscrira au cœur de la foi chrétienne et constituera l’axe central de la célébration dominicale, depuis lors jusqu’aujourd’hui.
Les préparatifs du repas pascal
Les disciples interrogent Jésus à propos de l’endroit où il souhaite manger le repas pascal. La réponse de Jésus semble alors indiquer qu’il avait déjà fait entente avec le maitre de la maison au sujet d’une salle que ce dernier lui offrirait pour l’occasion, puisqu’il envoie deux de ses disciples s’enquérir auprès de lui de l’endroit exact où se trouve cette salle.
À l’origine, cette fête se déroulait sur les parvis extérieurs du temple, ce qui n’était cependant plus possible au temps de Jésus, en raison de l’affluence des pèlerins. Elle devait néanmoins avoir lieu dans une salle à l’intérieur même de la ville de Jérusalem.
Une fois ladite salle localisée, les deux disciples auront pour tâche de la préparer et de pourvoir à tout le nécessaire pour que le groupe puisse y célébrer la Pâque. Nous n’avons pas plus de détails au sujet de cette salle, si ce n’est qu’elle sera vaste et située à l’étage ; ni plus de détails quant au déroulement des préparatifs en vue du repas. Rien n’est effectivement mentionné au sujet des rites qui caractérisent habituellement ce repas pascal. Le texte nous oriente plutôt vers ce qui constituera le cœur de la rencontre, en l’occurrence, le partage du pain et du vin.
Le partage du pain
Jésus et ses disciples sont donc attablés pour prendre le repas traditionnel de la Pâque. Traditionnel ? Et pourtant ! Les paroles qu’il s’apprête à prononcer sur le pain et le vin conféreront au repas une portée radicalement neuve, une dimension universelle.
Jésus procède cependant d’une manière très sobre. Il prononce la bénédiction sur le pain, le rompt et dit aux disciples : « Prenez ». Cette invitation au partage se veut déjà une exhortation à communier à une même cause. Suivent ces paroles tout à fait inédites qui dévoileront alors la portée de cette communion : « ceci est mon corps ».
Pour comprendre l’implication existentielle de l’invitation de Jésus à partager le pain symbolisant son corps, il importe de procéder à une brève incursion anthropologique en monde sémitique. Il est, en effet, essentiel de rappeler qu’en monde sémitique, la notion de corps n’est pas à prendre au sens anatomique du terme, comme c’est le cas dans la culture gréco-romaine, où il désigne la partie charnelle de la personne. Au contraire, pour le Juif, le corps désigne le ‘je’ dans toute son individualité, la personne dans son intégralité, âme, chair et esprit. Conséquemment, le corps d’un individu évoluera au fil du développement de sa personne ; au fil de ses choix de vie, de ses options, de ses croyances. De ce fait, on peut déjà présumer que si les disciples agréent à l’invitation de Jésus de prendre le pain et de s’en nourrir, ils communient ainsi à sa personne et s’engagent à épouser le mode de vie qu’il propose, à évoluer selon la voie qu’il a tracée.
Le partage de la coupe
Après avoir mangé le pain avec ses disciples, Jésus prend la coupe de vin, rend grâce à Dieu, puis la présente aux disciples pour qu’ils y boivent. Le sens symbolique qu’il attribue au vin est alors d’une importance capitale : « Ceci est mon sang ».
Tout comme la signification du corps diffère en monde sémitique par rapport à la culture gréco-romaine, ainsi en est-il également de la signification du sang. Des textes de la Bible sont clairs quant au sens attribué au sang : la vie d’une personne, c’est son sang ; sa vie coule dans son sang. Qu’il suffise de citer les deux passages suivants :
Mais, avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c’est-à-dire le sang (Genèse 9,4).
Car la vie d’un être de chair est dans le sang… la vie de toute chair est dans son sang (Lévitique 17,11.14).
La portée de cette parole de Jésus se veut alors fondamentale pour une lecture éclairée d’une étape centrale de la célébration eucharistique. Boire le vin symbolisant le sang du Christ signifie tout simplement s’alimenter à sa vie. Or, on sait que la santé du corps dépend en grande partie de ce dont il se nourrit. De la même manière, la santé de l’âme dépend, elle aussi, de ce dont elle se nourrit. À cet effet, un passage de la lettre aux Hébreux, deuxième lecture de ce dimanche, est clair : Le sang du Christ purifiera notre conscience. Autrement dit, communier au sang du Christ, c’est chercher éclairage en sa personne pour un choix de vie conforme à la volonté du Seigneur. Cela implique que l’on cherche toujours à éclairer ses choix personnels à la lumière de ce que seraient ceux de Jésus, Christ, en pareilles circonstances.
Le sang de l’Alliance nouvelle
Le texte de la lettre aux Hébreux apporte encore un éclairage important quant à la façon de comprendre cette Alliance nouvelle :
Voilà pourquoi (le Christ) est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un testament nouveau.
Une Alliance nouvelle implique qu’il y eut une Alliance antérieure. C’est de cette première Alliance qu’il est question en Exode 24,3-8. Rappelons que la première Alliance entre Dieu et son peuple est scellée par l’intermédiaire du sang d’un taureau immolé. De la part du peuple, elle consiste en une promesse d’observer la volonté de Dieu écrite dans la Loi transmise par l’intermédiaire de Moïse. Pour sceller cette entente entre Dieu et son peuple, Moïse asperge l’autel, laquelle symbolise la présence du Seigneur, de la moitié du sang recueilli, puis il asperge le peuple de l’autre moitié. Ainsi, par ce même sang, la relation de vie entre Dieu et son peuple est établie.
Si, de la part du peuple d’Israël, la condition du maintien de cette première Alliance consistait à observer la Loi transmise par Moïse, Jésus annonce aux disciples qu’il y a désormais renouvellement de cette Alliance en son sang. Qu’est-ce à dire ? Que désormais vivre selon la volonté du Seigneur ne se traduira plus simplement par l’observance d’une série de commandements, mais bien en adoptant un mode existentiel modelé sur celui que Jésus a préconisé.
Mais alors, comment sait-on que Jésus devient bel et bien la voie tracée pour un vécu en harmonie avec la volonté de Dieu ? Sa résurrection en est la réponse. En effet, en ressuscitant Jésus, Dieu a marqué de son sceau son approbation intégrale de tout ce que Jésus a dit et accompli. Plus besoin de mémoriser une liste de commandements à observer, mais bien de se demander, au jour le jour, comment Jésus réagirait face à telle ou telle situation ; se demander ce qu’il prônerait comme mode existentiel. La réponse ne saurait être autrement que génératrice de vie, d’amour, de justice, de respect.
Mais ce qui confère une portée tout à fait inédite à cette Alliance en Jésus, Christ, c’est qu’elle ne s’adresse plus seulement à un peuple en particulier, en l’occurrence, à celui d’Israël, mais au genre humain en général. En effet, Jésus précise : Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance versé pour la multitude. Bref, il n’y a plus de distinction raciale ; la vie de Jésus devient modèle pour l’ensemble des peuples. En Jésus, Dieu établit désormais une Alliance universelle.
Conclusion
La célébration eucharistique se veut essentiellement Mémorial de la Cène. Autrement dit, la participation à cette célébration doit mettre les fidèles en relation avec ce que Jésus a voulu transmettre au moment de son dernier repas avec ses disciples. Il n’a certainement pas alors demandé de l’adorer, mais bien d’épouser le mode de vie qu’il a, lui-même, privilégié. Si l’on paraphrase, on pourrait traduire ainsi sa volonté : si vous mangez ce pain, vous communiez à ma personne et par le fait même, vous vous engagez à vivre à la manière dont j’ai vécu et à actualiser ce que je vous ai enseigné. Si vous buvez ce vin, vous vous alimentez à ma vie et vous y puisez la force nécessaire pour agir selon la volonté de Dieu.
Envisager la participation au repas eucharistique sous cet angle en change complètement la perspective pour le croyant. Elle ne se résume pas à un moment ponctuel d’adoration, mais consiste plutôt en un engagement qui se prolonge au fil du quotidien. Le participant quitte alors la célébration avec la volonté d’agir au quotidien comme Jésus le ferait à sa place.
Odette Mainville est auteure et professeure honoraire de l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal.
Source : Le Feuillet biblique, no 2849. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation du Diocèse de Montréal.
