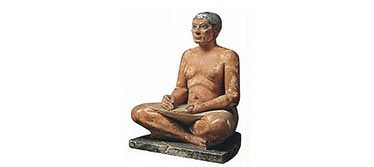Le désespoir de Job. William Blake, 1805. Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle, sur traces de mine de plomb. The Morgan Library, New York (Wikipédia).
Job dans les dialogues – Les textes d’espérance
 Hervé Tremblay | 27 mai 2024
Hervé Tremblay | 27 mai 2024
Connaître le livre de Job est une série d’articles où Hervé Tremblay nous introduit à un genre littéraire singulier et à une œuvre qui se démarque dans la grande bibliothèque qu’est la Bible.
Notre troisième regard sur les dialogues entre Job et ses amis se termine avec une surprise : l’espérance de Job. En effet, dans des discours très sérieux, parfois, ça et là, Job fait preuve d’une espérance surprenante, inexplicable et, il faut le dire, imprécise. Comme des nuages épais et sombres qui laissent rapidement passer le soleil, les quelques textes d’espérance ressortent soudainement pour disparaître aussitôt. Leur diversité même souligne que cette espérance n’est pas claire. Contrairement à plusieurs commentateurs ou prédicateurs, il ne faut pas s’empresser de conclure qu’ils concernent nécessairement Dieu. Logiquement, Job ne peut pas, d’un côté, accuser Dieu et le tenir responsable de ses malheurs et, de l’autre côté, avoir en lui son espérance. Si c’est le cas, il faut bien expliquer comment cela serait possible.
Notons d’abord que les mots « espérance / espoir » se rencontrent peu dans le livre, sinon pour affirmer qu’il n’y en a pas pour Job (cf. Jb 7,6 ; 13,15 ; 14,7-10 ; 17,13-15 ; 19,10 ; 30,26) ou pour clamer qu’il n’y en a pas non plus pour l’impie (8,13 ; 11,20 vs 11,18 ; 14,19 ; 27,8). Ce qui est remarquable, c’est que le vocabulaire de l’espérance se trouve souvent dans les chapitres où il y a l’un des textes dont nous parlons (Jb 7 ; 14 ; 19).
De quelle espérance parle-t-on ici? Pas de l’espérance d’être guéri ou libéré des souffrances. Nous avons dit à plusieurs reprises que Job est certain de mourir bientôt et qu’il n’attend pas la guérison. Il ne lui reste plus qu’une espérance après la mort ou une sorte de continuation de la vie, ce que nous appelons du terme théologique d’eschatologie. Mais, encore une fois, il faut bien se garder d’importer une notion qui n’était sans doute pas celle des auteurs du livre de Job. Continuons plutôt notre exploration.
Quels sont ces textes? Ils se répartissent dans les premier et deuxième cycles. Au chapitre 7, Job y affirme que la mort est certaine et proche. À la lecture de ce beau chapitre, on va se demander où est l’espérance, car c’est bien le contraire que Job affirme, surtout aux v. 9-10. Mais ce malaise qui peut être le nôtre aujourd’hui, les anciens lecteurs aussi l’ont éprouvé, eux qui ont eu foi en la vie dans l’au-delà. Nous en reparlerons plus loin.
En Job 14,13-15, on a un premier texte d’espérance imprécise. Job sent bien que le Dieu qu’il expérimente n’est pas celui en qui il croit. Deux visages contradictoires de Dieu s’affrontent. Aussi, Job se dit-il prêt à attendre de voir enfin ce vrai visage de Dieu. Il ne s’agit pas d’une espérance claire en la résurrection mais d’un souhait que, malheureusement, l’expérience contredit.
En 16,6-17, Job se plaint amèrement du comportement de Dieu à son égard. Puis, aux v. 18-22, il parle d’un « témoin » et d’un « garant ». Le v. 20 est difficile à comprendre en hébreu parce qu’il y a des mots qui se ressemblent beaucoup mais qui ont des sens différents. La Bible de Jérusalem (BJ) comprend : « Interprète de mes pensées auprès de Dieu, devant qui coulent mes larmes » ; alors que la TOB traduit : « Mes amis se moquent de moi, mais c’est vers Dieu que pleurent mes yeux ». Au v. 21 Job continue : « Qu’il défende l’homme contre Dieu ». Puisque ce verset commence avec « Qu’il », il est logique de supposer que le verset précédent parle encore de ce témoin. Si c’est le cas, c’est la traduction de la BJ qui serait à préférer, quoiqu’il reste à identifier ce mystérieux personnage. Dieu ne peut pas être le témoin / garant / interprète qui défendra l’homme contre Dieu ou interprétera ses pensées. Les commentateurs ont suggéré que ce témoin, c’était justement le sang de Job qui crie vers Dieu, dont il parle au v. 18 et auquel il fera encore allusion en 19,25 en parlant du « goel / vengeur du sang ».
La question rebondit en 17,3 où Job demande à Dieu d’être sa « caution ». Toper ou taper dans la main était le geste de celui qui se portait garant pour quelqu’un et arrêtait ainsi la saisie de ses biens en remboursement de la dette qu’il ne pouvait pas payer. Job se rend bien compte que personne ne peut le cautionner sauf Dieu lui-même. Est-ce que cela implique que le témoin de 16,19 est aussi Dieu? Peut-être, mais pas nécessairement.
Job 19,25-27 est un texte majeur du livre et l’un des plus connus. Il est célèbre à cause du chant des funérailles (« Je crois que mon sauveur est vivant ») et de l’aria du Messie de Händel juste après le fameux alléluia (I know that my Redeemer Liveth). Mais cette tradition interprétative vient des traductions grecque et latine, pas de l’hébreu. Le texte hébreu est très difficile et plusieurs croient qu’il est corrompu et incompréhensible (d’où la nécessité ou la tentation des traducteurs subséquents de le clarifier ou de le corriger).
« Je sais, moi, que mon rédempteur / défenseur / goel est vivant » (19,25). De qui Job parle-t-il? Le mot hébreu goel renvoie au « vengeur de sang ». Dans un système de justice très ancien, avant la formation des États, c’était au plus proche parent d’un membre du clan de rétablir la justice après un crime ou un tort quelconque. Ainsi, le vengeur de sang devait tuer l’assassin d’un membre du clan, tuer celui qui avait violé une femme du clan (Gn 34 viol de Dina ; 2 S 13 viol de Tamar par Ammon, plus tard tué par Absalom ; 2 S 14 la ruse de Joab pour faire revenir Absalom), racheter un terrain d’un membre du clan (Ruth 4,1-11), etc. C’était là une obligation sacrée à laquelle on ne pouvait pas se dérober. En effet, les anciens croyaient que le sang répandu injustement criait vers Dieu pour qu’on lui rendre justice. On se rappelle du cas d’Abel (Gn 4,10) ou de Job lui-même (Jb 16,18). Dans les textes bibliques, ce goel est rarement Dieu, sauf dans le Deutéro-Isaïe (Is 41,14 ; 43,14 ; 44,6.24 ; 49,7 ; 59,20) et deux fois dans les Psaumes (Ps 19,15 ; 78,35).
Si on comprend bien le texte hébreu de Job, celui-ci pensait que, après sa mort, son sang continuerait de crier justice vers Dieu. Ayant établi qu’il n’y a plus de membre de sa famille qui puisse venger son sang après sa mort (19,13-22), il affirme sa certitude qu’un être mystérieux jouera ce rôle. Dieu est-il le goel? De prime abord, il est difficile de répondre par la négative, vu la tradition chrétienne unanime, mais ce n’est pas si évident. Si on lit bien le texte, le goel permettra à Job de voir Dieu. Job est certain que sa mort approche et qu’il n’aura pas eu justice. Il lui reste à espérer que justice lui sera rendue après sa mort.
De quelle façon? La réponse se trouvait sans doute aux v. 25b-26a, mais c’est justement là que le texte est corrompu. Le v. 25b porte bien en hébreu « il (le goel) se lèvera sur la poussière » et non pas « Je me lèverai sur la poussière » comme chante le cantique des funérailles, traduisant la vulgate latine. Dans le contexte, « se lever » ferait référence à un procès ou une action en justice. Le goel se lèvera pour rendre justice à Job. Le v. 26b est le plus difficile de la section. Le verbe en hébreu est impossible à comprendre et les traductions font tout au plus des suppositions éclairées (educated guesses). Il ne s’agit pas ici d’entrer dans les détails d’un texte complexe étudié par la critique depuis des siècles sans qu’il n’y ait jamais consensus. Quoi qu’il en soit, le v. 26b arrive à la conclusion claire : « Et de (à partir de) ma chair, je verrai Dieu », non pas « dans ma chair », qui vient encore de la version latine. On sait que le christianisme primitif y a vu un prélude de la foi en la résurrection, mais, à l’origine, « dans ma chair » est un sémitisme qui signifie l’humain dans son identité concrète.
Dans les textes que nous venons de voir brièvement, Job montre une espérance qui s’exprime en une gradation :
- Premièrement, les questions sur le caractère inéluctable de la mort au chapitre 7.
- Puis le rêve impossible d’un arbitre ou d’un conciliateur qui poserait sa main sur Dieu et sur Job dans le but de les amener face à face, qui s’exprime pour la première fois en 9,33.
- Ensuite la conviction qu’après sa mort, Job recevrait de son mystérieux témoin une défense posthume qui lui rendrait justice (16,12-21).
- Finalement la certitude de la présence ultime d’un goel / vengeur de sang qui vengera son sang ou le rachètera et lui permettra de voir Dieu (19,25-27).
Nous disions que l’espérance de Job n’est pas claire. L’espérance l’est-elle jamais? Le mystère de l’identité de l’intermédiaire entre Dieu et Job reste entier. S’agit-il toujours de la même personne ou de personnages différents? S’il n’est pas clair ou logique que ce(s) personnage(s) imprécis soi(en)t Dieu lui-même, puisqu’ils doivent être intercesseur ou intermédiaire entre Job et Dieu, qui sont-ils? Les théories n’ont pas manqué mais elles ne viennent pas toujours du texte (par exemple, on a parlé d’un ange, mais le livre n’en parle jamais au sens où nous l’entendons). Disons seulement qu’une étude stricte du texte donne à penser que le candidat le plus plausible est le sang de Job qui crie justice. On sent bien que cette explication n’est pas totalement satisfaisante parce qu’elle n’a pas le caractère personnel supposé par les textes en question, à moins qu’on veuille faire allusion à la vie du sang, selon la conception ancienne. Mais on n’a pas vraiment mieux à proposer.
Eschatologie
Au plus profond de la dépression, Job semble s’accrocher à une espérance imprécise comme à une bouée, pour ne pas sombrer. Mais pour lire et comprendre le livre de Job, il est essentiel de se rappeler qu’une eschatologie outre-tombe ne faisait pas encore partie de la foi d’Israël et qu’on croyait que tous les défunts allaient indistinctement au shéol, les bons comme les méchants, dans une espèce de demi-vie inintéressante (Jb 7,9.10.21 ; 10,21 ; 14,1-12 ; 16,22). C’est pourquoi, selon le principe de rétribution, il était extrêmement important que justice soit rendue sur terre. La croyance en la résurrection apparaîtra bien plus tard. Ses premières manifestations peuvent se voir dans les livres des Maccabées (2 M 7 ; 12,38-45) et dans le livre de Daniel (Dn 12,2-3), tous deux datant de la crise maccabéenne de 165 avant J.C.
Job orgueilleux?
C’est une question que nous avons déjà posée et qui revient naturellement ici. Tout au long du livre, Job se montre entêté et obstiné. Entêté dans son affirmation d’innocence, entêté dans son exigence de justice, entêté dans son espérance apparemment sans fondement. Job est-il orgueilleux? Il faut se garder d’être dur envers lui et se rappeler que, à la fin du livre, Dieu lui-même affirmera que Job a parlé de lui avec droiture (cf. Jb 42,7). Il serait donc plus exact de penser que Job est honnête du début à la fin de son aventure, et que c’est pour cette raison que Dieu fait son éloge. Jusqu’à la fin, Job garde la dignité d’un homme qui se sait innocent et qui le crie, un homme qui espère que cette innocence sera reconnue de son vivant ou après sa mort.
Adaptations subséquentes
On comprend que les traducteurs, des siècles après la rédaction de Job, n’aient pas pu résister à la tentation d’actualiser le livre non seulement parce que les croyances avaient évolué, mais aussi parce que les propos de Job avaient surpris et choqué des générations de croyant.e.s qui n’avaient pas atteint son niveau de questionnement. L’imprécision de l’espérance de Job ainsi que la grande difficulté du texte hébreu y ont aussi contribué. Aussi, certains milieux se sont-ils attachés à le corriger ou à le rendre orthodoxe ou à éliminer son aspect scandaleux. On pense au targum de Job (la traduction en araméen, souvent interprétative) ou à l’écrit apocryphe appelé Testament de Job. Mais ici nous ne parlerons que de la Septante grecque et un peu de la vulgate latine.
La Septante est la traduction de la Bible hébraïque en grec. Commencée vers 250 avant J.C. à Alexandrie en Égypte pour une communauté juive qui ne comprenait plus l’hébreu, le livre de Job aurait été traduit vers la fin du 1er siècle de notre ère. Ce qu’il est important de comprendre, c’est que, entre le livre de Job en hébreu (vers 450 avant J.C.) et sa traduction en grec (vers l’an 100), la foi d’Israël avait connu des changements significatifs. L’un d’eux touchait l’eschatologie ou les fins dernières, plus spécifiquement la survie dans l’au-delà. Cela signifie que les traducteurs de la Septante n’adhéraient plus à la croyance ancienne au shéol mais croyaient en la résurrection. On comprend leur malaise à traduire ce en quoi ils ne croyaient plus ou, pire, à le voir nier dans les propos de Job et de ses amis. Les traducteurs, qui ne travaillaient pas comme ceux d’aujourd’hui, ont donc « adapté » ou « actualisé » le texte. Il y a des cas célèbres dans le livre de Job.
En Job 7,9 il a suffi aux traducteurs de mettre des points d’interrogation réels ou sous-entendus à ce qui était des affirmations en hébreu. Voici ce que cela donne :
| Texte hébreu | Septante grecque |
Comme la nuée se dissipe et passe, qui descend au shéol n’en remonte pas. |
Comme la nuée se dissipe et passe, qui descend dans l’Hadès n’en remonte-t-il pas? |
De même au chapitre 14,13-14 :
| Texte hébreu | Septante grecque |
Oh ! Si tu m’abritais dans le shéol, si tu m’y cachais, tant que dure ta colère, si tu me fixais un délai, pour te souvenir ensuite de moi : – car, une fois mort, peut-on revivre ? – tous les jours de mon service j’attendrais, jusqu’à ce que vienne la relève. |
Oh ! Si jamais tu me gardais dans l’Hadès, si tu m’y cachais, jusqu’à ce que se calme ta colère, si tu me fixais un moment pour faire mémoire de moi. Car si l’humain meurt, il vivra, ayant accompli les jours de sa vie ; j’attendrai jusqu’à ce que je sois de nouveau / que je renaisse. |
Job 19,25-26 est le texte d’espérance le plus célèbre et le plus retouché par les traducteurs anciens. Comme nous le disions, le texte hébreu est quasiment impossible à comprendre. Qu’à cela ne tienne! Les traducteurs vont rendre clair ce qui ne l’est pas en hébreu.
Conclusion
On voit que notre exploration rapide des textes d’espérance dans les dialogues de Job aurait pu aller plus loin. Ce que nous avons fait montre la vie du texte biblique au long des siècles : constamment relu, réinterprété, actualisé, rendu présent.
Mais une lecture du seul texte hébreu nous laisse un peu sur notre faim. Job espère, certes. Mais nous ne savons pas trop ce qu’il espère, et lui ne semble pas trop le savoir non plus. Quoi qu’il en soit, à la toute fin du livre, Job se dira entièrement comblé parce que son espérance aura été accomplie : « Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t’ont vu », claire référence à 19,26-27.
Dans le prochain article, nous reprendrons notre commentaire du livre de Job en nous concentrant sur les chapitres qui suivent les dialogues et concluent le livre.
Hervé Tremblay est professeur au Collège universitaire dominicain (Ottawa).