
(NOAA / Unsplash)
Risquer l’avenir
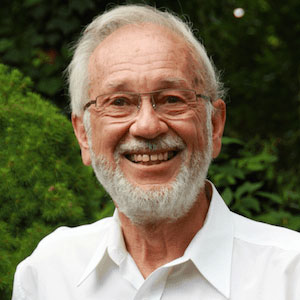 Paul-André Giguère | 2edimanche de l’avent (C) – 8 décembre 2024
Paul-André Giguère | 2edimanche de l’avent (C) – 8 décembre 2024
La prédication de Jean le Baptiste : Luc 3, 1-6
Les lectures : Baruc 5, 1-9 ; Psaume 125 (126) ; Philippiens 1, 4-6.8-11
Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.
Multiplication des ouragans de plus en plus violents, aggravation d’inondations catastrophiques, dévastation accélérée des forêts par des incendies hors contrôle, mortalité accrue du fait de la concentration en particules fines... Eh bien, ce 8 décembre est la Journée mondiale du climat. Un climat de plus en plus incontrôlé et incontrôlable, bref, gravement malade. Nous sommes plongés au cœur d’une pandémie climatique ; nos mesures timides et tardives de prévention ne font plus le poids et l’état du monde nous semble presque incurable.
Pendant ce temps, comme étrangères au drame actuel, la plupart des communautés chrétiennes semblent ailleurs, replongeant dans l’antiquité biblique pour célébrer le deuxième dimanche de l’Avent en se nourrissant de textes prophétiques usés, alors que d’autres préféreront peut-être méditer sur l’Immaculée Conception de Marie, la mère de Jésus.
Les textes bibliques proposés pour ce deuxième dimanche de l’Avent sont pourtant de nature à renforcer, voire peut-être faire naître, un regard positif sur l’avenir au moment même où nous enfonçons de manière accélérée dans le chaos. J’y trouve un antidote au défaitisme, à la résignation cynique et à l’écoanxiété. Mais à la condition de ne pas se contenter de plaquer leurs mots sur nos inquiétudes à la manière d’un “plaster” sur une plaie purulente.
Trois textes, trois contextes, une même ouverture
Le livre deutérocanonique de Baruc est un ouvrage hétéroclite. Sa structure quadripartite ressemble un peu à celle des psaumes de supplication : Après la description du malheur vécu par le peuple, suivie de sa longue et insistante supplication, une méditation sur la sagesse fournit un socle sur lequel on prend pied pour retrouver la parole d’espérance de la liturgie d’aujourd’hui. Dans une situation désespérée, le texte parle pourtant d’avenir : « Dieu se souvient », « Dieu a décidé », « Dieu conduira Israël dans la joie ».
La chaleureuse lettre de Paul aux chrétiens de Philippes est plus lumineuse, car l’action du Dieu fidèle qui s’est manifesté dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus a fait son œuvre. Pourtant, à lire la lettre que Paul leur adresse, les Philippiens ne vivent pas dans un monde de licornes. Ils ont à « lutter sans se laisser intimider » et à « souffrir pour le Christ » (1,27-30), alors que beaucoup, déplore Paul, sont tentés de se comporter en « ennemis de la croix du Christ » (3,18). Ce qui est de nature à surmonter ces mises à l’épreuve, c’est une attitude tournée vers l’avenir : Dieu va « achever » ce qu’il a commencé, et Paul prie pour que l’amour des Philippiens « progresse ». L’attitude chrétienne, en effet, est d’être, comme Paul, « tout tendu vers l’avant » (3,13), « inquiets de rien » (4,6), car « le Seigneur est proche » (4,5) et viendra « transfigurer notre corps humilié » (3,21).
Quant aux premiers mots de l’extrait de l’évangile de Luc, ils évoquent la soumission politique et sociale des contemporains de Jésus, assujettis à l’empereur romain et à son gouverneur, ainsi qu’à un roi sans légitimité qui, comme son frère, doit tout à la puissance impériale. C’est dans ce sombre contexte que s’élève une voix improbable qui proclame un avenir : « tout être vivant verra le salut de Dieu ».
Usé par l’attente du salut (Psaume 119,81)
Au fond, tous ces textes proclament, dans des contextes historiques très différents, l’action d’un Dieu sauveur. Tantôt ils l’appellent, tantôt ils la rappellent, tantôt ils la célèbrent et l’espèrent. Dans les prédications proposées durant l’Avent aux assemblées chrétiennes, ne parle-t-on pas souvent de la venue du « Sauveur » en choisissant des textes qui annoncent sa venue et anticipent son action?
Salut, on le sait, est de la même racine que santé. La spiritualité des Premières nations fait une large place à la guérison qui touche non seulement le corps, mais aussi la mémoire, la perte, l’agression. La guérison est également un terme récurrent chez les victimes de violence sexuelle. Ce sont deux exemples actuels qui révèlent que le thème chrétien du salut n’est pas sans pierres d’attente dans notre culture malade souffrant d’inquiétude et, parfois, de désespoir.
Ne faut-il pas admettre pourtant que ce salut, même nous, chrétiens, avons peine à le voir? Depuis notre haute antiquité spirituelle, le psaume 119 nous met dans la bouche des mots d’une brûlante actualité spirituelle que, sans eux, nous n’oserions peut-être pas exprimer dans notre prière : « Usé par l’attente du salut... l’œil usé d’attendre tes promesses, j’ai dit : "Quand vas-tu me consoler"? »
Le salut au présent
Nous avons bien besoin de cette pédagogie de l’Avent pour nous accorder un temps où désemparés, inquiets, pessimistes, nous quittons notre angoisse personnelle pour plonger ensemble dans la détresse commune et dire, toujours avec les psalmistes : « Jusqu’à quand, Seigneur? » Un temps pour dire, avec Jésus lui-même : « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, sauve-moi de cette heure? » (Jean 12,27).
Mais nous avons un problème. C’est que nous sortons de siècles où la question du salut était une affaire strictement individuelle et hors du temps. On chantait encore, quand j’étais jeune, ces mots de Louis-Marie Grignon de Montfort « Je n’ai qu’une âme qu’il faut sauver, de l’éternelle flamme il faut la préserver ». Comme si le sort du monde ne nous concernait pas vraiment. Comme si le salut ne concernait que soi et, surtout, ne s’accomplissait que de l’autre côté de la mort.
N’est-ce pas pourtant « la gloire de Dieu et le salut du monde » non seulement que nous attendons, mais auquel nous consacrons nos énergies? Un salut pour maintenant, pour aujourd’hui, comme le dit le rituel catholique : « Donne la paix à notre temps... en cette vie où nous espérons ».
De plus, la modernité a bousculé certaines croyances chrétiennes sur le salut, en particulier celle d’un monde futur qui serait une humanité nouvelle où régnerait le Christ revenu dans la gloire et d’où le mal, la souffrance, les larmes et le deuil auraient disparu. Ce mythe de la fin glorieuse de l’aventure humaine ne tient plus la route. Un jour, inexorablement, notre étoile aura perdu son énergie, et comme toutes les autres dans l’univers immense, elle se refroidira et toute vie disparaîtra sur notre planète.
Non, il en va autrement de notre foi dans le salut de Dieu. L’activité de Jésus s’exerçait « aujourd’hui », auprès des malades de toute sorte auxquels il aimait dire : « Ta foi t’a sauvé ». L’Avent est une période de grâce qui invite chacune et chacun, mais aussi chaque communauté, à vérifier jusqu’où il ou elle est, ici et maintenant, instrument de salut dans son milieu ou comment il ou elle pourrait le devenir compte tenu des détresses et situations de précarité de son époque et de son environnement.
Ne faudrait-il pas être comme Jésus à Jéricho qui, en entrant chez Zachée, comble le fossé au-delà duquel le chef des collecteurs d’impôts de la ville était tenu à l’écart par la population de la ville? Il dit ce mot que, comme chrétiens, nous devrions prononcer régulièrement parce que nous aurions su faire le premier pas et posé les gestes qui sauvent et qui libèrent : « Aujourd’hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc 19,9-10).
Espérer le Dieu qui vient
Dans un texte éclairant sur l’espérance, le théologien André Gounelle propose de distinguer le futur et l’avenir. Le futur, c’est ce que nous pouvons anticiper à partir d’une observation attentive du présent. C’est ainsi que procèdent les scientifiques en observant, par exemple, la progression de la fonte de la calotte glaciaire ou la concentration de CO2 dans l’atmosphère. Ils peuvent projeter la situation climatique dans 10 ou 50 ans. Le futur, c’est la continuation du présent dans ses conséquences.
L’avenir, pour sa part, serait d’une tout autre nature. Il désigne ce qui « advient », l’inattendu qui vient vers nous. Il y a, bien sûr, dans l’avenir, des choses ou des événements que nous pouvons déjà entrevoir. Mais il y a tout ce qui est imprévisible et parfois même, improbable. Cette distinction nous est utile alors que nous progressons vers ce-qui-advient, Advent en anglais ou en allemand. Le temps de l’Avent, c’est justement le temps du désir de ce (Celui) qui vient vers nous.
Soit nous laissons les inquiétudes du futur nous déprimer et nous paralyser, soit nous nous investissons dans ce présent parce que nous avons confiance en Dieu qui a de l’avenir en réserve pour l’humanité. André Gounelle a cette formule heureuse : « L’avenir ne se borne pas à ce qui nous arrive, il naît aussi de ce que nous faisons du présent, alors que le futur apparaît comme ce que le présent fait de nous [1]. »
Diplômé en études bibliques et en andragogie, Paul-André Giguère est professeur retraité de l’Institut de pastoral des Dominicains (Montréal).
[1] André Gounelle, « Espérance » (andregounelle.fr).
Source : Le Feuillet biblique, no 2868. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation du Diocèse de Montréal.
