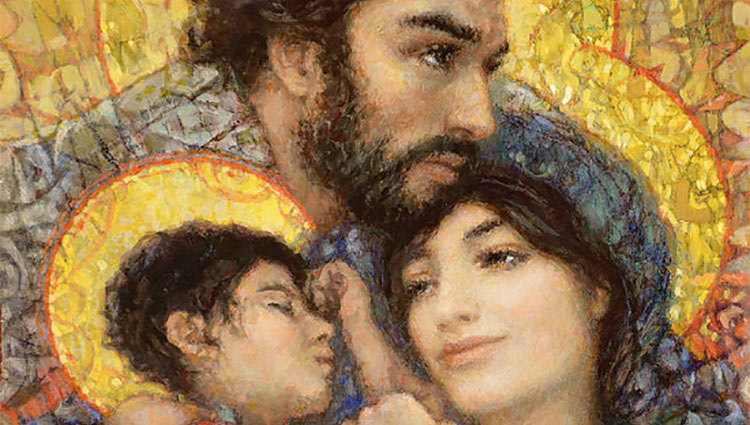
La Sainte famille. © Cameron Smith, 2021.
Acrylique sur panneau, 35,5 x 45,7 cm. Collection privée (image : courtoisie de l’artiste).
Comment chercher Jésus ?
 Francis Daoust | Sainte famille (C) – 29 décembre 2024
Francis Daoust | Sainte famille (C) – 29 décembre 2024
Premières paroles de Jésus au Temple : Luc 2, 41-52
Les lectures : 1 Samuel 1, 20-22.24-28 ; Psaume 83 (84) ; 1 Jean 3, 1-2.21-24
Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.
Tout juste avant de commencer à raconter le ministère de Jésus, l’Évangile de Luc rapporte l’épisode de l’enseignement du jeune Nazaréen au Temple (2,41-52). Et tout juste après avoir décrit la mort du Christ, il raconte l’histoire des disciples d’Emmaüs (24,13-35). Ces deux récits sont propres au troisième évangile, comportent de nombreux points communs et se répondent l’un l’autre. Lus ensemble, ils nous indiquent comment chercher Jésus et où le trouver.
Une structure délibérée
Ces deux récits présentent trop de points communs pour qu’il s’agisse d’une simple coïncidence. Dans chaque épisode, on retrouve en effet deux personnages qui sont en quête de Jésus, alors qu’ils quittent Jérusalem, après la fête de Pâque. Ils ne cherchent ni au bon endroit, ni la bonne personne, rendent compte de la souffrance qu’ils ont éprouvé dans leur entreprise et se font reprocher leur manque d’intelligence. Ils finissent par trouver Jésus après trois jours, dans un rapport aux Écritures.
C’est donc à dessein que l’Évangile de Luc encadre le long récit du ministère de Jésus entre ces deux quêtes. Par ce procédé littéraire, Luc présente son évangile comme une longue quête pour Jésus, comme un long cheminement faisant appel à notre intelligence et à notre discernement afin de comprendre où il est possible de trouver Jésus et de saisir quelle est son identité profonde. On peut d’ailleurs affirmer que la recherche entamée par Marie et Joseph se conclut, en quelque sorte, dans celle des disciples d’Emmaüs. La première se terminait en effet dans l’incompréhension : « Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait » (2,50), alors que la seconde se solde par une révélation : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? » (24,32).
Chercher aux mauvais endroits
Dans chacun des récits, les recherches des personnages ne sont pas conduites aux bons endroits. Marie et Joseph, en effet, tentent de trouver leur enfant dans le convoi des pèlerins, sur le chemin menant à Jérusalem, puis dans la ville elle-même. Leurs efforts se limitent au monde profane. Or c’est au Temple qu’ils trouveront Jésus, dans la sphère du sacré, en train d’écouter et de questionner les docteurs de la Loi, ces spécialistes des Écritures.
Les disciples d’Emmaüs, eux aussi, cherchent Jésus dans le monde profane, en considérant les « événements » (24,18.19) de l’arène politico-religieuse, là où le Nazaréen fut livré par les grands prêtres et les chefs du peuple. Mais c’est dans les Écritures qu’ils le découvriront, là où leur cœur était brûlant quand Jésus leur en faisait l’interprétation. Ils sont ainsi invités à chercher la volonté de Dieu, non pas dans la superficialité des péripéties du monde profane, mais dans leur signification profonde, en scrutant la Loi et les Prophètes. C’est ainsi qu’ils arriveront à comprendre quel est le véritable plan de salut offert par Dieu et à saisir comment ce projet se réalise : par un passage obligé du Christ par la souffrance. À noter cependant que, bien que les deux disciples soient appelés à consulter les Écritures pour comprendre ce qui se rapporte au Christ, celui-ci ne se trouve pas dans un livre, mais à leur côté, sur la route, cheminant avec eux.
En évoquant les visites au tombeau, les disciples d’Emmaüs indiquent qu’ils cherchent aussi Jésus parmi les morts. Ils rapportent bien que les anges ont dit aux femmes que Jésus était vivant, mais ils focalisent leur attention sur l’absence du corps de celui-ci : « Elles n’ont pas trouvé son corps » ; « Mais lui, ils ne l’ont pas vu » (24,23.24). La double mention du tombeau (24,22.24) révèle bien l’endroit où se focalisent leurs pensées. C’est cependant dans la fraction du pain, dans ce geste de don de vie, qu’ils reconnaîtront « le Vivant » (24,5).
Chercher la mauvaise personne
Dans ces deux récits, les quêtes des chercheurs de Jésus ne sont pas dirigées non plus vers la bonne … personne! Marie et Joseph, en effet, sont à la recherche de leur fils. Leur quête se situe essentiellement sur le plan familial : ils cherchent d’abord leur enfant parmi leurs parents et connaissances (2,44), puis, lorsqu’ils le trouvent, soulignent le lien de sang qui les unit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! » (2,48) Jésus leur répond en resituant sa filiation dans un cadre plus large. S’il est bien leur enfant sur le plan terrestre, il est le fils du Père sur le plan céleste : « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père? » (2,49). Durant son ministère, Jésus rappellera à nouveau à sa parenté quels sont ses véritables liens familiaux : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la Parole de Dieu et la mettent en pratique. » (8,19-21)
De leur côté, les disciples d’Emmaüs avaient mis leur espoir en un « homme », « Jésus de Nazareth », qu’ils considéraient comme un « prophète ». Mais la personne qu’ils trouveront sur leur route est plus qu’un prophète. Ce n’est pas une personne qui parle dans les Écritures, mais la personne dont parlent les Écritures. Il s’agit du Christ, dont témoignent Moïse et les Prophètes.
Les deux quêtes de Jésus décrites dans ces deux récits mettent bien en valeur le rôle central des Écritures. C’est au milieu des docteurs de la Loi que Marie et Joseph trouvent le jeune homme et c’est en se faisant interpréter les Écritures que les disciples d’Emmaüs cheminent avec le Christ.
Triple remplacement
La mise en parallèle de ces deux récits permet également d’observer que les docteurs de la Loi du premier récit sont remplacés, dans le deuxième, de trois manières.
En tant que leaders religieux, ils sont remplacés par les grands prêtres et les chefs du peuple qui livrèrent Jésus (24,20). Au dialogue du premier récit se substitue la fourberie du deuxième. Ce changement témoigne bien de l’envenimement des relations et du rejet de Jésus par les autorités religieuses de son temps.
En tant que spécialistes des Écritures, ils sont remplacés par Jésus. Ce dernier était à l’écoute des maîtres dans le premier récit et parlait déjà avec intelligence. Mais c’est lui, sur le chemin d’Emmaüs qui parle désormais avec autorité ; lui seul est à même d’interpréter correctement les Écritures en ce qui concerne le Christ.
En tant que partenaires de dialogue, ils sont remplacés par les disciples d’Emmaüs. C’est avec eux maintenant que Jésus discute des Écritures. Cette observation est précieuse pour nous aujourd’hui, car nous sommes, nous aussi, des partenaires de dialogue avec le Christ, qui marche avec nous et nous ouvre les Écritures. Avec lui, l’accès à la Parole de Dieu n’est pas limité aux spécialistes, mais à toute personne désirant mieux la comprendre et mieux s’en nourrir.
Nous pourrions aussi affirmer que les docteurs de la Loi du premier récit sont remplacés par l’Église naissante. Ce ne sont plus eux qui font désormais autorité, mais les Écritures elles-mêmes et le témoignage des femmes et des Apôtres.
Comment chercher Jésus?
Nous vivons dans un monde inquiétant où les « événements » (24,18.19) peuvent nous troubler. Nous sommes alors à la recherche de réponses et pouvons nous demander où est le Christ dans tout cela. Les deux récits de quête avec lesquels Luc encadre le ministère de Jésus peuvent cependant nous éclairer. Ils nous invitent à ne pas chercher de sens dans la superficialité des événements, mais à les considérer à la lumière du plan de Dieu tel qu’il est révélé dans les Écritures.
Ces deux récits montrent aussi à quel point Jésus est en dialogue, avec les docteurs de la Loi, avec Marie et Joseph, avec les disciples d’Emmaüs et avec nous aujourd’hui. Il s’agit bien d’un dialogue, et non d’un discours magistral, comme en témoignent les nombreuses questions de Jésus (2,46.49 ; 24,17.19.26). Ce dernier nous encourage à lui répondre, à parler, à entrer en dialogue avec lui. Ce n’est pas en demeurant muets et en l’ignorant que nous arriverons à trouver des réponses.
Ces deux récits nous invitent finalement à reconnaître la véritable identité de Jésus. Il n’est pas un simple « enfant » (2,48), un simple « homme » (24,19) ou un simple « prophète » (24,19). Il est le Fils de Dieu (2,49) et le Christ (24,26). Il est celui qui interprète les Écritures avec autorité, celui qui dialogue et marche avec nous et qui se fait découvrir dans la fraction du pain.
Francis Daoust est bibliste et directeur de la Société catholique de la Bible (SOCABI).
Source : Le Feuillet biblique, no 2871. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation du Diocèse de Montréal.
