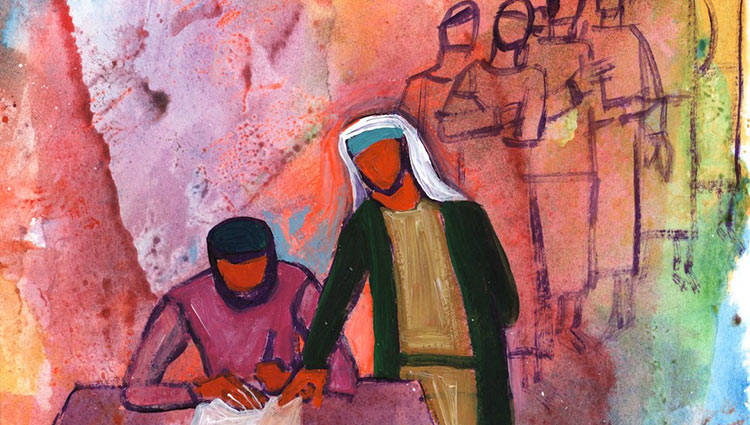
Le gérant lui dit : « Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et écris cinquante. »
Illustration: Bernadette Lopez (Évangile et peinture).
Gérant incompétent devenu astucieux
 Christiane Cloutier Dupuis | 25e dimanche du Temps ordinaire (C) – 21 septembre 2025
Christiane Cloutier Dupuis | 25e dimanche du Temps ordinaire (C) – 21 septembre 2025
La parabole du gérant habile : Luc 16, 1-13
Les lectures : Amos 8, 4-7 ; Psaume 112 (113) ; 1 Timothée 2, 1-8
Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.
L’évangile d’aujourd’hui propose un ensemble de textes plutôt qu’un seul récit. Ce qui oblige à traiter plusieurs questions. En effet, « Lc 16, 1-13 pose une série de problèmes difficiles : quel est le lien entre la parabole et les diverses applications qui en sont données dans les vv. 9-13? Quelle est la finale primitive? Le verset 8a ou le verset 8 au complet (8a.b)? Au v. 8 kurios désigne-t-il le maître de l’intendant (vv. 3 et 5 deux fois) ou Jésus lui-même? [1] »
Résumons la parabole
Nous voyons un intendant accusé par son maître de dissiper ses biens. Il semble qu’il ne soit pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que le texte spécifie qu’il a « dissipé », « dilapidé » ou « gaspillé » les biens de son maître, ce qui n’était pas a priori dans son intérêt. Il pourrait donc n’être qu’un gestionnaire incompétent ou négligent plutôt que malhonnête. Écoutons ce que la parabole raconte : son maître le convoque, lui ordonne de remettre ses comptes et de partir : « Rends les comptes de ta gestion car tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Il doit donc présenter les livres de comptes pour son successeur et s’il a été un mauvais gestionnaire, son avenir est sombre. Il doit réfléchir et trouver une solution. On l’entend réfléchir à voix haute : « Que vais-je faire? « Mon maître me retire la gérance », « je ne puis pas », « j’en ai honte », « je vais faire », « quand je serai relevé … » Sa réflexion est centrée uniquement sur lui. À l’évidence, il se fiche des affaires qu’il devait gérer pour son maître. Il n’en a cure. Cela explique peut-être en partie sa mauvaise gestion et le verbe utilisé signifiant « dilapider ou gaspiller » plutôt que voler. C’est intéressant de voir que poussé au pied du mur, il devient subitement inventif, créatif. Ne dit-on pas que «nécessité est mère des inventions »? Il en est un puissant exemple. Au Québec, beaucoup de personnes diraient qu’il s’est « viré sur un dix cents ». Subitement, il apparaît comme homme d’affaires sans scrupule et astucieux. Étonnamment, il est capable d’imaginer une solution simple, facile et payante, autant pour lui que pour les débiteurs de son maître (vv. 5-7).
Il demande d’abord à chacun le montant qu’il doit, ce qui est renversant car c’est lui qui devrait le savoir. C’était cela son travail. C’est ce détail qui confirme son incompétence ou sa négligence plutôt que le vol. Le premier avoue devoir cent sacs d’huile et le second cent sacs de blé. Il propose alors au premier une réduction de dettes de 50%, ce qui est considérable et au second une réduction de 20%, ce qui est impressionnant aussi. Seule l’exégèse peut nous révéler ce que sont ces réductions. Même si leur valeur varie selon que l’on consulte le 1er Testament, les écrits de Qumrân ou Flavius Josèphe, on découvre qu’il s’agit de 100 baths d’huile pour le premier débiteur et que le second doit 100 kors de blé. Ce sont de très grosses quantités : 3500 litres d’huile et 2000 litres de blé [2]. Il y a plus de 60 ans, Joachim Jeremias évaluait cette remise de dettes en deniers pour cette époque plutôt qu’en argent pour notre temps [3]. Il estimait que la dette du premier équivalait à 1000 deniers et celle du second à 2500 deniers, soit l’équivalent du salaire de trois à cinq ans d’un ouvrier agricole! Il est évident qu’une telle remise de dette sera récompensée et son désir exaucé : « qu’il y ait des gens qui m’accueillent chez eux ». On assiste en direct à cette fraude où comble de l’insouciance ou de l’incompétence, c’est le débiteur lui-même qui écrit le montant de sa dette et qui reçoit en échange un reçu validant le faux montant. Il y a de quoi nous scandaliser même au 21e siècle.
Arrive alors la finale surprenante : Et le maître fit l’éloge du gérant trompeur parce qu’il avait agi avec habileté. Ce qui signifie que « le maître l’a découvert », preuve ultime de son incompétence! En réalité, Jésus raconte cette parabole pour placer ce fameux logion, à savoir que le maître fait l’éloge du gestionnaire. Il avait compris combien il faut être astucieux et combien on doit faire preuve d’intelligence et d’accommodations pour faire passer le message. En fait, il est beaucoup question d’inculturation et d’acculturation ici.
Origine de la parabole
Luc aurait reçu de la tradition cette parabole que l’on ne retrouve dans aucun autre récit évangélique. Il y a accord unanime chez les exégètes sur deux points : Luc a transmis fidèlement la parabole. Et les vv. 9-13 n’étaient pas primitivement liés à la parabole, mais lui ont été ajoutés soit par Luc, soit par un compilateur prélucanien. Pour certains exégètes, Jésus se serait inspiré d’un fait divers connu des auditeurs. Curieusement, la question qu’on se pose depuis des siècles est de savoir si la parabole s’arrête au v. 7 ou se termine au v. 8. Car il n’y pas entente entres spécialistes sur la question de « qui parle » au v. 8a et 8b., le maître de l’intendant ou Jésus? Pourquoi ce dilemme? À cause de mot grec kurios. Question qui, de prime abord peut laisser de glace n’importe quel lecteur du 21e s., mais qui a quand même son importance.
Le verset 8a a posé question au sujet du mot kurios traduit par « maître », les experts se demandant si le mot kurios désigne le maître du gérant ou Jésus. Ils ont développé cinq arguments pour démontrer que c’est le maître qui parle et six arguments pour démontrer que c’est Jésus (à titre informatif seulement). Retenons seulement que derrière cette recherche argumentaire pointue se cache la question : Jésus aurait-il pu louer la malhonnêteté? Quand on lit attentivement le récit, il semble pourtant logique que le v. 8a relève de Jésus puisque le v. 8b vient de lui et explicite le pourquoi de cette louange : c’est une interpellation aux fils de lumière pour qu’ils fassent preuve eux aussi de débrouillardise. En effet, quel intérêt Jésus aurait-il eu à raconter un simple fait divers et pourquoi la tradition en aurait-elle conservé la mémoire s’il n’y avait pas eu une leçon importante à retenir en entendant pareil verset : « Et le maître loua ce gestionnaire malhonnête car il agit (« il fit », trad. litt. du grec epoihsen) de façon avisée »? Je rapporte ce fait uniquement pour faire réaliser à quel point ce qui peut avoir scandalisé ou interpelé durant des siècles les responsables ecclésiastiques à cause des conséquences morales selon que le « maître » est Jésus ou pas, ne dérange plus personne. Surtout que nous vivons dans une période où nous aurions bien besoin que les « fils de lumière soient » le soient réellement! C’est loin d’être évident pour quiconque travaille en Église… On a souvent l’impression que la Lumière est éteinte!
Puisque nous devons traiter des versets 9 à 13, voyons quels sont les liens entre ceux-ci et la parabole. Ces versets ajoutés par Luc ou par un compilateur prélucanien, présentent diverses interprétations liées à la parabole. Il est frappant de voir le parallélisme entre les vv. 4 et 9: « je sais ce que je ferai » vs « faites-vous des amis »; « pour que lorsque j’aurai été éloigné, ils me reçoivent dans leurs maisons » vs « pour que lorsque l’Argent disparu, ils vous reçoivent dans leurs tentes éternelles ». À l’évidence, le v. 9 fait corps avec la parabole. On devrait donc en tenir compte dans l’interprétation de celle-ci et ne pas l’enfermer dans une seule façon de lire ou de comprendre. De plus, on se demande si ce v. 9 été composé pour faire une suture avec les versets 10-12 même s’il y a un hiatus entre eux et ce verset : on passe, en effet, du partage de l’argent avec les pauvres pour se faire des amis à la fidélité à apporter pour la plus « petite affaire » y compris l’usage de l’argent. On met l’accent sur la confiance et ses conséquences quand celle-ci n’est pas au rendez-vous. On met aussi en garde aussi contre l’argent « trompeur ». Il faut savoir que dans l’Antiquité l’argent était représenté par le dieu Mamon. D’où le v. 13 qui est une mise en garde sur qui l’on veut servir.
Actualisation
1. La parabole nous interpelle directement en tant que « fils/filles de lumière ». Jésus semble avoir constaté que les « fils de l’ère » (trad. littérale signifiant les fils du monde) se montrent beaucoup plus inventifs et créatifs que les fils de lumière pour trouver des solutions et développer leurs relations. Il met l’accent non seulement sur l’ingéniosité de ceux-ci mais aussi sur leur rapidité. Quand on constate la lenteur de notre Église à s’ajuster au monde du 21e siècle, à son manque d’imagination totale pour s’adapter, intéresser, attirer les gens en quête de sens ou à la recherche d’une spiritualité, on en déduit que cette interpellation n’est pas entendue! C’est donc aux laïcs à entendre cet appel et à se montrer créatifs en misant sur leurs compétences professionnelles, leur art de s’ajuster, leur meilleure connaissance du cœur humain parce que totalement immergés dans le monde avec les souffrances et les problèmes de celui-ci. Parce que capables de reconnaître ses besoins, percevoir ses attentes, discerner ses beautés et ses richesses. Les laïcs doivent réaliser que c’est à eux à prendre en main leur Église dépassée par le temps, les cultures émergentes et les événements. Dépêchons-nous. Le temps presse!
2. Il est important de souligner le v. 9 qui donne un conseil extraordinaire sur l’art de gérer notre argent et de nous conduire en authentiques enfants de Dieu. Tromper l’Argent trompeur qui veut qu’on l’adore en le trompant à notre tour, c’est-à-dire en partageant cet argent (selon nos moyens et notre capacité) avec les personnes dans le besoin.
3. Suivent les vv. 10-12 qui nous invitent à nous montrer fidèles, « dignes de confiance » dans la gestion des biens temporels afin d’être jugés dignes d’une bonne gestion des biens spirituels. Jésus nous invite à nous montrer fidèles et à devenir des chrétiens.nes dignes de confiance. Autrement dit, nous sentir responsables en tant que chrétiens.nes et à nous investir dans notre communauté.
4. Le v. 13 nous met devant un choix radical : servir Dieu ou servir Mamon, le dieu Argent. Nous baignons dans un monde tellement matérialiste où la surconsommation est reine. Cette interpellation de Jésus est brûlante d’actualité et concerne chacun et chacune d’entre nous. À nous d’y réfléchir sérieusement.
Formatrice spécialisée en études bibliques, Christiane Cloutier Dupuis détient un doctorat en Sciences religieuses (option Exégèse) de l’UQÀM.
Source : Le Feuillet biblique, no 2900. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation écrite du site interBible.org.
[1] Gérard Rochais, notes de cours UQÀM, 1995.
[2] Michel Gourgues, Les paraboles de Luc, éd. Médiaspaul, 1997, p. 174.
[3] Joachim
Jeremias, Les paraboles de Jésus, éd, Xavier Mappus, 1962, p. 240.
