
« L’homme qui marche » (à droite), une sculpture d’Alberto Giacometti (Kari Nousiainen / Flickr).
L’homme qui marche
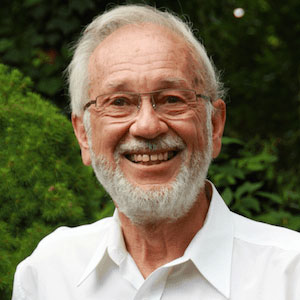 Paul-André Giguère | 28e dimanche du Temps ordinaire (C) – 12 octobre 2025
Paul-André Giguère | 28e dimanche du Temps ordinaire (C) – 12 octobre 2025
Guérison de dix lépreux : Luc 17, 11-19
Les lectures : 2 Rois 5, 14‑17 ; Psaume 97 (98) ; 2 Timothée 2, 8-13
Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.
Ah! Wow! Quelle chance : cette année, le dimanche du congé de l’Action de grâce nous offre le récit de la guérison des dix lépreux dont un seul revient vers Jésus « en lui rendant grâce ». Une aubaine pour les personnes chargées de faire l’homélie ou... pour un rédacteur de cette chronique! Le thème est tout trouvé, servi sur un plateau d’argent : il suffira d’inviter les auditeurs ou les lecteurs à cultiver une attitude d’action de grâce dans leur vie, de savoir reconnaître en tout ce qui est bon un signe de la grâce de Dieu. Amen.
C’est « ben correct ». On a bien le droit à un peu de « lousse » de temps en temps.
Sauf que... Emprunter cette voie de la facilité, ne serait-ce pas se contenter à bon compte d’une réflexion moralisatrice comme tant de prédicateurs l’ont fait malheureusement pendant des décennies (O.K., lointaines, d’accord, mais ça a laissé des traces). Une réflexion du genre : ne soyez pas comme les neuf ingrats qui ne sont pas revenus « rendre grâce »... Et si Luc nous entraînait... ailleurs?
Quelques observations sur le texte
Avez-vous remarqué que tout le monde bouge tout le temps dans ce récit de Luc, dont l’habileté littéraire ne cessera de me surprendre? En neuf petits versets, il utilise pas moins de huit fois des verbes de déplacement : marcher, traverser, entrer, venir à la rencontre, aller, en s’en allant (en cours de route), revenir sur ses pas, et de nouveau, aller! Ça doit bien vouloir dire quelque chose!
Personne n’est immobile ici : ni Jésus, ni les lépreux, ni celui d’entre eux qui est Samaritain. Les déplacements des personnages sont plus que de simples indications de mouvements qu’un metteur en scène proposerait aux acteurs pour que l’action soit plus dynamique. Ces déplacements de tout le monde ne sont pas le décor, mais bien l’âme de ce qui se joue sur cette scène « entre la Samarie et la Galilée ».
L’âme de toute expérience spirituelle, n’est-elle pas le mouvement? Et cela, depuis le tout premier appel à la foi, adressé à celui qui s’appelait encore Abram. « Pars (ou va). Quitte ton pays et marche vers le pays que je te montrerai ». [...] « Abram partit et Loth partit avec lui. » (Genèse 12,1.4) Les expériences fondatrices de la foi biblique ont été vécues sous le mode de la sortie, de l’ailleurs : sortie risquée hors de l’Égypte, sortie forcée vers Babylone, sortie des Douze du Cénacle animés par la découverte de celui qui est sorti du tombeau et qui, selon Matthieu (28, 19) leur enjoint d’« aller dans le monde entier ».
À cette lumière, l’immobilisme et le conservatisme sont une maladie de l’âme.
Observons maintenant comment Luc débute le récit d’aujourd’hui en parlant de la frontière : « la région entre la Samarie et la Galilée ». Mais qu’est-ce donc que cela? Qu’est-ce que cette frontière « entre »? N’est-on pas soit d’un côté, soit de l’autre de la ligne? Il n’y avait pas de no man’s land entre la Galilée et la Samarie. C’est comme si Jésus traversait sur la ligne. Comme pour la neutraliser. Comme si, pour lui, elle n’existait pas. Galiléen ou Samaritain, juif ou étranger : qu’importe pour le Jésus de Luc. Ce dernier ne se plaît-il pas à relever comment Jésus était touché par la foi du centurion (7,9), du Gérasénien (8,38), du Samaritain (10,37) ?
Ce qui intéresse Jésus, c’est l’humain.
De même, – et nous l’avons vu lors de la pandémie de Covid 19 – la maladie et la souffrance ne connaissent pas de frontière. Il n’y a pas neuf lépreux juifs et un lépreux samaritain. Il y a dix lépreux. Tout court. Dix personnes souffrantes unies dans le mépris et l’exclusion. Dix personnes que leur condition forçait à « se tenir à distance ». Mais à être toujours « à distance », selon les exigences de la Loi (Lévitique 13,46), ne sont-ils pas condamnés à être, finalement, nulle part?
Une troisième observation mérite d’être faite. Jésus désigne le Samaritain sous le terme « cet étranger ». Alors qu’ailleurs dans le Nouveau Testament, l’étranger est généralement appelé xenos (qui nous a donné xénophobie), Luc choisit ici le terme allogenès : la personne qui est « née ailleurs », celle qui ne vient pas du même monde que les autres. N’en est-il pas ainsi de Jésus? Il y a plus de 50 ans le théologien dominicain Marie-Joseph Le Guillou avait intitulé son livre sur le Christ : L’Innocent. Celui qui vient d’ailleurs. Et cela me rappelle que combien, chez Jean, l’origine de Jésus demeure source de controverse : d’où vient-il? De Nazareth! Mais encore... (Jean 6,42 ; 7,27-28).
Bref, entre allogènes, on se comprend tout de suite.
Risquons une dernière observation sur ce texte qui peut encore être lu en référence à la pensée de Paul, qui fut l’apôtre de ceux qui n’étaient pas d’origine juive et dont Luc fut un proche compagnon. Pour Paul, ceux qui, comme le Samaritain, ne sont pas soumis à la Loi mosaïque, sont également sauvés par la foi en Jésus. Ainsi, comme en Luc 8,38, les lépreux coreligionnaires de Jésus restent soumis à la Loi mosaïque, d’où l’injonction d’aller se montrer aux prêtres. Mais celui qui est né ailleurs, qui vient d’ailleurs, est libre de venir directement à la source du salut.
Où cela nous mène-t-il?
Je pense d’abord à l’étonnante sculpture qu’Alberto Giacometti a intitulée « L’homme qui marche ». Dans son dépouillement, cette œuvre montre un être humain affranchi de toute référence à un sexe, un âge, une appartenance sociale, une culture. C’est comme si l’artiste avait réussi à exprimer l’essence même de l’humain : un être dressé sur ses deux jambes et dont la nature est d’avancer, libre et tête haute.
Forcés de se tenir à l’écart, les dix lépreux ne pouvaient aller nulle part, et voilà qu’ils peuvent aller qui vers les prêtres, qui vers Jésus, sans entrave, sans aucun lien qui leur colle à la peau. Librement. Vers quelque chose qui ressemble à la vie.
Je pense aussi au tout petit livre que Christian Bobin a intitulé, lui aussi, « L’homme qui marche ». Ce livre est une méditation sur Jésus dont le poète saisit une dimension essentielle : « Il marche. Sans arrêt il marche. Il va ici et puis là. Il passe sa vie sur quelque soixante kilomètres de long, trente de large. Et il marche. Sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. »
Alors, bien sûr, il ne cessait et ne cesse aujourd’hui encore de répéter : « Viens, suis-moi ». Il dit clairement qu’être son disciple, c’est « marcher à sa suite », c’est avoir la liberté d’avancer dans sa vie affranchi de toute dépendance à son métier, à son pays, à sa famille même, intérieurement libre par rapport à l’argent ou aux traditions religieuses. Le Jésus de Jean 10 est encore plus explicite. Que fait le pasteur avec ses brebis, image de tout disciple du Christ? « Il les emmène dehors. Lorsqu’il les a toutes fait sortir, il marche à leur tête et elles le suivent (v. 3-4). Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé, il ira et viendra » (v.9).
Voilà ce qu’il accorde aux dix lépreux : la liberté retrouvée d’aller et de venir plutôt que d’être confinés à vivre « à distance ». Ailleurs, Jésus décrira encore son agir en rappelant la parole d’Ésaïe : « Les boiteux marchent ». M’est d’avis que nous sommes tous et toutes un peu lépreux, avec des complexes qui nous collent à la peau et nous font nous tenir à l’écart de la vie et des autres. M’est d’avis que nous sommes tous un peu boiteux, marchant lentement d’un pas hésitant alors que notre destinée, c’est de nous élancer et de courir, selon le joyeux témoignage de Paul (Philippiens 3,12-14).
N’y a-t-il pas là une source continuelle d’action de grâce?
Diplômé en études bibliques et en andragogie, Paul-André Giguère est professeur retraité de l’Institut de pastoral des Dominicains (Montréal).
Source : Le Feuillet biblique, no 2903. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation du Diocèse de Montréal.
