
L’apparition du ressuscité au bord du lac. James Tissot, 1886-1896. Aquarelle opaque et graphite, 14,9 x 23 cm. Brooklyn Museum, New York.
Franchir la frontière
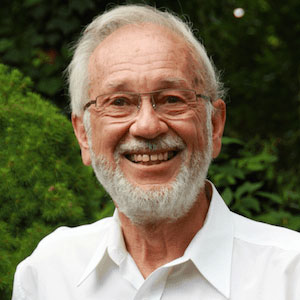 Paul-André Giguère | 3e dimanches de Pâques (C) – 4 mai 2025
Paul-André Giguère | 3e dimanches de Pâques (C) – 4 mai 2025
L’apparition au bord de la mer : Jean 21, 1-19
Les lectures : Actes 5, 27b-32.40b-41 ; Psaume 29 (30) ; Apocalypse 5, 11-14
Les citations bibliques sont tirées de la Traduction liturgique officielle.
La fin du dernier siècle a vu l’évanouissement partiel des frontières : accords de Schengen en Europe, multiplication des traités et accords de libre-échange entre pays, âge d’or d’organisations comme Médecins « sans frontières » ou Reporters « sans frontières ». L’humanité se découvre une.
Mais voici que sous la pression des migrations massives, la protection de la frontière s’est glissée au premier plan du discours politique, particulièrement aux États-Unis. Protéger, contrôler, renforcer, mais sans aller jusqu’à la fermeture hermétique de la frontière, comme ce fut le cas durant la pandémie, et qui s’est révélée source d’immenses problèmes.
Alors, qu’en est-il des frontières de nos vies personnelles? Celles de notre identité, celles de notre vie morale, celles de nos convictions profondes? Voilà l’angle sous lequel nous allons examiner le début du chapitre 21 de l’Évangile de Jean.
L’évangile des frontières
L’Évangile de Jean est bien connu pour son langage binaire. Sa pensée est dualiste : lumière/ténèbres, foi/doute, recevoir/refuser, vérité/mensonge, croire/ne pas croire, être du monde/ne pas être du monde : autant de contrastes sans nuances qui suggèrent une sorte de frontière qui séparerait un monde d’un autre et que le Christ invite chacun à franchir au prix d’une décision que la tradition appelle conversion.
On discutera encore longtemps de l’énigmatique chapitre 21 qui a toutes les apparences d’un ajout. Pourquoi donc cette addition inattendue? Qu’y avait-il donc encore à dire après le chapitre 20, où l’on voit les disciples de Jésus entrer dans la dynamique pascale, faite d’inattendu et d’improbable, au prix de moments d’alternance entre doute et affermissement? Peut-être un auteur a-t-il éprouvé le besoin de « péter la balloune » de ceux qui, riches d’être de ceux qui ont cru sans avoir vu, s’imaginaient une fois pour toutes du bon côté de la foi.
Les frontières ouvertes
Le récit de la rencontre du Ressuscité et de quelques uns de ses disciples « sur le bord de la mer de Tibériade » joue, lui aussi, sur des oppositions [1] , comme autant d’invitations à un passage – n’est-ce pas de Pâques qu’il s’agit? Il est question de mer et de rivage, de nuit et de lever du jour, de filets vides et de filets remplis, de n’avoir rien à manger et de recevoir un déjeuner frugal, de ne pas savoir et pourtant de reconnaître, de gros et de petits poissons, d’être nu et de passer un vêtement, de savoir que c’est le Seigneur mais de ne pas demander « Qui es-tu? »...
Ne s’agit-il pas d’un appel au franchissement d’une frontière auquel tous les « disciples », donc nous-mêmes, sont conviés? Le récit met en scène sept des onze apôtres de Jésus. Manifestement, après le désastre de la mort de leur maître, quittant Jérusalem, ils ont franchi la frontière de leur province, la Galilée, et, comme s’ils régressaient dans leur vie antérieure à la rencontre de Jésus, ont relancé leur entreprise de pêche. De plus, à lire ces premiers versets du chapitre 21, c’est presque comme s’ils n’avaient rien vécu de ce dont il est question au chapitre précédent : le tombeau vide, la révélation à Marie de Magdala, la rencontre du Ressuscité dans la maison aux portes verrouillées, le don de l’Esprit et la mission de « remettre les péchés », le doute et la foi de Thomas. Dans une barque, sur cet élément instable qu’est la mer, ils sont nus dans la nuit et dans cette nuit, ils ne prennent rien.
De l’autre côté d’une invisible frontière, se tient un homme qui se trouve, lui, sur le terrain solide qu’est le rivage, et sa présence coïncide avec le lever du jour. Cet homme leur parle : « Avez-vous quelque chose à manger? », alors que nous allons vite découvrir qu’il avait déjà fait un feu sur lequel il a mis à cuire du pain et des petits poissons. Les pêcheurs qui ont répondu « non, nous n’avons rien à manger », trouvent pourtant, à sa parole, une surabondance de poissons, dont le texte dit qu’ils étaient nombreux (153) mais, aussi, gros. Pierre alors se jette à l’eau et, à la manière d’un baptême, se rend jusqu’au rivage, jusqu’à cet inconnu dont, alerté par « le disciple que Jésus aimait », il pressent pourtant l’identité.
La main tendue
Il importe de se rappeler que si l’on accepte de jouer le jeu que le chapitre 21 fonctionne comme s’il n’y avait pas eu le chapitre 20, un grand écart, un gouffre, presque, séparait l’inconnu du rivage et ceux qui se tenaient dans la barque. En effet, Pierre avait par trois fois renié son maître, et les autres l’avaient abandonné. Ils étaient même revenus à leur vie antérieure. Dans nos histoires humaines, les expériences de trahison et de rupture créent une distance souvent infranchissable, à la manière d’une frontière impénétrable. Mis en présence de Jésus qu’ils avaient abandonné et renié, ses disciples inconstants devaient éprouver un malaise palpable et une honte insurmontable.
Mais voilà que loin de leur faire des reproches et de les ramener à ce passé dont ils ne sont pas fiers, Jésus s’intéresse simplement à eux. Voilà que quelqu’un s’inquiète pour eux qui sont sûrement découragés par la stérilité de leur travail de la nuit. « Les enfants, avez-vous pris quelque chose? » Une parole toute simple, presque banale, mais qui recrée du lien, à la manière d’un timide apprivoisement entre deux personnes qui se sont disputées. Après la question de Jésus, viendront sa proposition de jeter de nouveau le filet, mais aussi ce feu réchauffant et ce déjeuner frugal qu’il a préparé. Aucune animosité. Un espace recréé pour la relation et pour la confiance. Une main tendue par-dessus la frontière de la rancœur, du ressentiment et de la honte. Un passage s’effectue. La relation est rétablie.
Le plus grand ou le plus petit
Notre texte présente deux autres oppositions très intrigantes, indécelables dans la majorité des traductions, y compris la traduction liturgique. Lorsque le texte parle des poissons qui remplissent les filets des disciples, il utilise le terme bien connu de iktus (ὶχθύς), mais quand il mentionne ceux que le Ressuscité a préparé et distribue, il préfère systématiquement le diminutif opsarion (όψάριον), qui désigne le petit poisson, comme ceux que généralement les pêcheurs rejettent à l’eau. De même, alors que l’embarcation est désignée par le terme ploion (πλοῑον), la barque, elle devient, au verset 8, plus petite ploarion (πλοαριον), une chaloupe quoi!
Observons encore que dans ce bref récit, le mot « disciple » revient sept fois. Voilà sûrement une clé d’interprétation. C’est bien de nous qu’il s’agit, chrétiens soumis, comme tout le monde, à la nécessité de gagner notre vie par un travail souvent frustrant et parfois apparemment stérile.
Où donc cela nous mène-t-il? Nulle part ailleurs que sur les différentes frontières de nos existences. Chaque franchissement de frontière implique, nous le savons, d’une part un dépouillement par rapport à notre existence telle que vécue jusque là, d’autre part un dépaysement devant un monde nouveau pour nous dont il faut apprendre à apprivoiser les codes et où entrer dans une nouvelle définition de nous-mêmes, de notre identité véritable.
L’identité de l’humain est d’être disciple, c’est-à-dire en permanente condition d’apprenti. Notre récit révèle qu’en dépit de la stérilité de nos efforts nocturnes, le Vivant est toujours là, à la frontière de nos espoirs les plus profonds comme de nos rêves de grandeur. Il se tient sur le rivage qui symbolise l’objet de notre impétueuse aspiration à une vie pleine. Si la résurrection de Jésus ouvre sur une surabondance de vie – et on peut évoquer ici les « myriades de myriades et milliers de milliers » d’élus que mentionne la deuxième lecture, il ne faut pas voir celle-ci sous le mode de la puissance et de la gloire.
Comme disciples, nous avons toujours à réapprendre que les derniers sont les premiers, que les plus petits sont les plus grands et, surtout, que l’essentiel est donné gratuitement. Les gros poissons pêchés péniblement cèdent la place aux petits poissons reçus gratuitement. La foi pascale fait entrer au pays de la grâce seule, affirment les Réformateurs. Presque anonyme sur nos rivages, le Ressuscité nous convoque à une vie toute simple et dépouillée où tout est donné pour être partagé, où tout nous ramène à l’essentiel.
Laisser la barque devenir chaloupe, et les filets remplis à tout rompre de gros poissons faire place à quelques petits poissons offerts sur un feu de braise : quel passage! Quelle Pâque!
Diplômé en études bibliques et en andragogie, Paul-André Giguère est professeur retraité de l’Institut de pastoral des Dominicains (Montréal).
[1] L’intuition de base de cette méditation nous est donnée par Guy Lafon dans son CD-ROM La Table de l’Évangile, Éd. de la Nouvelle Alliance, Clamart, 2010.
Source : Le Feuillet biblique, no 2889. Toute reproduction de ce commentaire, à des fins autres que personnelles, est interdite sans l’autorisation du Diocèse de Montréal.
