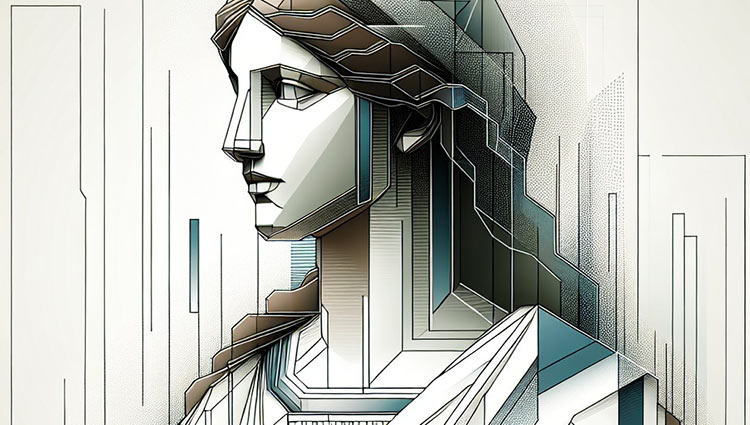
(image © Digital Bible)
D’ombres et de lumière : 12 récits de femmes de la Bible
 Renaude Grégoire | 11 novembre 2024
Renaude Grégoire | 11 novembre 2024
Comme les deux années précédentes, je vous propose de poser un regard neuf et de réfléchir avec des récits de femmes et de filles de la Bible, illustrant les diverses formes de violence dont elles peuvent être des victimes directes ou indirectes. D’autres récits bibliques présentent des femmes apportant de la lumière et de l’espoir. Au total, douze récits pour les 12 jours, entre le 25 novembre et le 6 décembre.
25 novembre : La fille d’Osée et de Gomer
Le second enfant du prophète Osée et de Gomer, celle-ci étant identifiée comme une prostituée, est une fille (voir Osée 1). Le Seigneur dit à Osée : « Appelle-la Lo-Rouhamah, car désormais je n’aurai plus pitié de la maison d’Israël ; je ne lui pardonnerai plus. » Difficile de porter un tel nom pour une petite fille, un nom qui évoque l’absence de miséricorde et de pitié, un nom qui la relie à l’infidélité du peuple envers son Dieu. Un poids bien lourd à porter. Aujourd’hui, la prostitution est encore considérée d’un point de vue moral et on condamne souvent les femmes qui la pratiquent. Peu de gens s’intéressent vraiment aux causes et aux conséquences du système prostitutionnel pour les femmes et les filles. Et pourtant, maintenir les femmes et les filles dans ce système sert ceux qui en profitent…
26 novembre : Rispa
Rispa a donné deux fils à Saul (voir 2 Samuel 21,10). Mérab a donné cinq petits-fils à Saul. David a fait prendre et livrer ces sept fils aux Gabaonites, afin que ceux-ci puissent se venger. Les Gabaonites « les pendirent sur la montagne devant Yahvé ; les sept moururent ensemble » au premier jour de la moisson et on laisser les corps là. Malgré l’horreur de la situation, Rispa va protéger les corps des oiseaux le jour et des bêtes sauvages la nuit, afin qu’ils ne soient pas dévorés. Elle le fera durant plusieurs mois, du premier jour de la moisson aux premières pluies. Aujourd’hui, ce récit évoque les femmes qui cherchent le corps de membres de leurs familles disparus ou tués dans des guerres et des conflits.
27 novembre : Les pleureuses
Dans cet appel prophétique, Dieu ordonne de faire venir les pleureuses (voir Jérémie 9,16-21) et demande aux femmes de montrer à leurs filles les chants funèbres : ce n’est pas pour feindre le deuil. La catastrophe de l’exil est proche et les lamentations des femmes décrieront les ravages de la mort, de la faim et de la guerre. Aujourd’hui, des femmes composent des chants illustrant la violence dont sont victimes les leurs et les femmes de leur contrée ou du monde.
28 novembre : La femme que l’on voulait lapider
Dans ce récit bien connu (voir Jean 8,1-11), c’est devant Jésus que cette femme sans nom est amenée pour être lapidée. La femme est la seule prise en flagrant délit d’adultère – l’homme fautif est absent ainsi que le mari de la femme. Jésus retourne les accusateurs à leur propre vie. Les accusateurs n’osent pas lancer de pierres... On pourrait croire que la lapidation est chose du passé. Or, elle peut prendre d’autres formes. Aujourd’hui, entre autres, les réseaux sociaux sont un moyen où se déchaine la haine envers les femmes et les filles, ce que plusieurs d’entre elles dénoncent.
29 novembre : Marie de Magdala
Il s’agit de prononcer le nom de Marie-Madeleine pour que tout de suite on dise : c’est la prostituée! Une femme de mauvaise vie! Cette étiquette colle toujours à celle qui a suivi Jésus et bien que Marie de Magdala soit la première qui a rencontré le Ressuscité et la première à l’annoncer aux disciples de Jésus (voir Jean 20,11-18). Des étiquettes sont facilement données aux femmes, sans compter les insultes et les humiliations dont elles sont victimes en privé et en public. Force est de constater que certaines personnalités connues utilisent les insultes pour se faire du capital.
30 novembre : Rodé, traitée de folle
Cette servante (voir Actes 12,12-17) est sans doute au bas de l’échelle sociale. Pierre est en prison et la communauté prie pour lui. Rodé a des oreilles et entend la voix de Pierre à la porte qu’elle reconnait. Au lieu d’ouvrir, elle va annoncer la nouvelle aux personnes en prière. On la traite de folle. Elle insiste et on lui répond que c’est l’ange de Pierre. Finalement, on finit par ouvrir la porte et Pierre est bien là. Aujourd’hui, dans certains réseaux, on peut identifier des résistances face aux bonnes nouvelles que portent des femmes qui sont au bas de l’échelle sociale et ecclésiale. Quelle attention portons-nous à leur bonne nouvelle?
1er décembre : Lydia hors des murs
Lydia, vivant au 1er siècle sous l’empire romain, est une chercheuse de Dieu (voir Actes 16). Elle est marchande et par son métier, elle doit négocier, rencontrer beaucoup de gens. Elle ne cherche pas à donner de la place au divin dans les lieux officiels, mais se retire hors de la ville de Philippes, en direction de la rivière. Elle n’est pas seule, d’autres femmes sont avec elle. Son cœur est ouvert et sa foi nouvelle, signifiée par son baptême après sa rencontre avec Paul. Sa maison est ouverte. Aujourd’hui, saurons-nous comprendre que des femmes cherchent hors des murs et des institutions une expérience spirituelle?
2 décembre : La veuve au Temple
Les pierres et les ornements du Temple de Jérusalem provoquaient l’admiration. Être veuve était une des situations les plus difficiles à vivre : sans ressources, souvent servante dans leur famille, quelques fois en situation presque d’esclavage ou devant demander l’aumône aux passants. Elles sont parmi les plus invisibles dans la société de Jésus. Or Jésus met le doigt sur le don que fait cette veuve, alors qu’elle prend sur sa misère (voir Luc 21,1-4). Aujourd’hui, avons-nous les yeux ouverts pour reconnaitre que des femmes puisent dans leurs ressources pour continuer de soutenir les leurs?
3 décembre : La veuve qui demande justice
Une autre veuve! Dans une parabole (voir Luc 18,1-8)! Mais le titre du passage donné par les éditeurs dans certaines bibles qualifie la veuve d’importune, ce qui est négatif. Or, elle demande justice, et la justice est dans les mains d’un juge qui se fout des humains et de Dieu. Elle ne lâche pas le morceau et insiste, insiste, insiste. Aucun autre moyen de rétablir ce qui a été fait par son adversaire. Aujourd’hui, la justice est-elle à l’écoute des femmes, des vies brisées par la violence, l’exploitation, les agressions? Quels pas doivent être faits?
4 décembre : Loïs et Eunice
Deux femmes sont mentionnées par Paul à Timothée : la grand-mère et la mère de celui-ci (voir 2 Timothée 1,3-5). Elles sont mentionnées comme étant des femmes de foi, une foi que Timothée a vu en paroles et en actions. Deux femmes qui ont influencé la vie de Timothée et que Paul reconnait d’emblée. Aujourd’hui, ne laissons pas se perdre la mémoire des femmes de foi qui ont eu une grande influence sur notre Église, notre foi, notre société, nos valeurs. Plusieurs d’entre elles ont été victimes de préjugés, d’exclusion et de violence, ont vu des obstacles se dresser sur leur chemin ou ont été méprisées pour leurs œuvres, même si plus tard on a reconnu leur importance.
5 décembre : La Samaritaine, du puits à l’annonce
On a beaucoup écrit et commenté sur la Samaritaine (voir Jean 4,1-42). On a beaucoup illustré cette rencontre entre Jésus et cette femme au puits de Jacob. Mais combien de commentaires ont mis en lumière qu’elle fut la première à annoncer aux Samaritains qu’elle a rencontré quelqu’un qui lui a dit tout ce qu’elle a fait. Or pas de honte, pas de culpabilité. Au contraire, une libération, une joie d’annoncer que le Christ est un libérateur. Notre Église annonce-t-elle un Dieu libérateur?
6 décembre : Les filles qui prophétisent
Une seule ligne dans le livre des Actes sur les quatre filles de Philippe… comme une évidence. Philippe, un des sept diacres, a quatre filles qui prophétisent (Actes 21,9). Cette mention n’est pas anodine. Paul va préciser dans sa première lettre aux Corinthiens (14,3) ce que signifie prophétiser : quand on prophétise, « on affermit les autres, on les encourage et on les instruit ». Des filles et des femmes de toutes sortes d’horizons et de milieux encouragent et partagent leur savoir pour le bien commun. Les reconnaissez-vous dans votre milieu?
Renaude Grégoire est engagée dans des réseaux de justice sociale depuis une vingtaine d’années. Elle collabore à divers projets de justice sociale, de paix et de protection de l’environnement.
