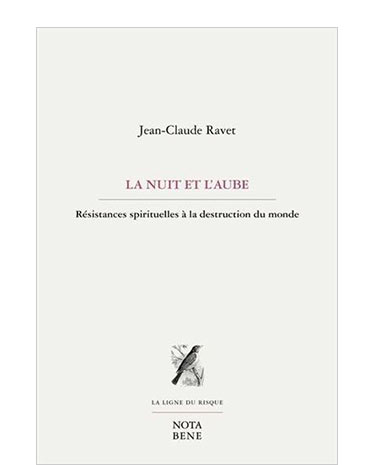(Necati Ömer Karpuzoğlu / Pexels)
Ce que signifie accueillir Dieu dans notre monde actuel
 Jean-Claude Ravet | 13 janvier 2025
Jean-Claude Ravet | 13 janvier 2025
Notre époque est étrange qui pense s’être libérée de la question de Dieu et, du même coup, de la religion dans la compréhension du monde, de l’existence et du combat à y mener. La connaissance scientifique et technique en effet les aurait rendu dorénavant impertinent, au même titre que le souci, non moins vaine, de la vie intérieure et de la quête de sens.
Notre époque est étrange qui pense s’être libérée de la question de Dieu et, du même coup, de la religion dans la compréhension du monde, de l’existence et du combat à y mener. La connaissance scientifique et technique en effet les aurait rendu dorénavant impertinent, au même titre que le souci, non moins vaine, de la vie intérieure et de la quête de sens.
Pour arriver à ce constat, il a fallu qu’une doxa hégémonique s’impose, adossée au savoir techno-scientifique, pourvoyeuse de puissance, de richesse et de réponses pratiques. La richesse monétaire, le confort et la consommation des biens sont la seule condition suffisante au bonheur. Tout ce qui en détourne, ne serait-ce qu’un tant soit peu, se doit d’être éradiqué ou neutralisé. On peut vivre bien mieux et apaisé une fois lestés des questions spirituelles, poids inutiles et encombrants. La publicité envahissante et tentaculaire consolide cette idée, en faisant de la vie des gens riches et célèbres, aussi insignifiante que superficielle, le modèle du bonheur : y rêver étant la condition suffisante par rassurer l’ordre capitaliste conquérant pour lequel l’appât du gain est élevé au rang de valeur cardinale.
Le jugement de Bernanos, dans les années 1940, est implacable : « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l’on n’admet pas d’abord qu’elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. »
Au Québec, un courant de pensée tend à s’imposer dans l’espace médiatique, selon lequel il faudrait même bannir toute manifestation de vie religieuse dans les lieux publics, étant soi-disant toxique et dangereuse socialement. Qu’est-ce qui pousse ainsi à ne voir dans la religion et en Dieu que toxicité et danger pour en exiger l’invisibilité et le silence? Exit la richesse de leurs spiritualités et regards pluriels sur les grandes questions de sens, et leurs apports sur le vivre ensemble, la justice sociale, la solidarité et le partage. Exit toute réflexion sereine sur Dieu, en dehors de tout dogmatisme et prosélytisme. La laïcité devient prétexte à l’affirmation intransigeante de l’impertinence de la question de Dieu autant que de la religion. Pour se justifier, elle pose comme exemplaires ses franges réactionnaires et fanatiques. Elle tourne ainsi radicalement le dos à une conception de la laïcité autrement plus positive et harmonieuse entre croyances et incroyances.
La question de Dieu à la lumière de la tradition biblique
Au cœur de la question du sens se love et taraude l’existence le mot-abîme qu’est Dieu. Depuis la nuit des temps bibliques, il accueille les cris, les plaintes, les souffrances, les espoirs étouffés – ceux des Abel, des Jérémie, des Rachel, des Job de l’histoire. Et il les mue en force inespérée permettant de supporter et de combattre la mort hideuse qui rode, avant son heure, sous la figure, aux mille têtes atroces, du malheur, du mal, de l’injustice et du non-sens. Témoin fidèle, contre toute espérance, que les bourreaux et l’injustice régnante n’auront pas, quoi qu’ils prétendent, le dernier mot. Dieu peut être le plus puissant antidote contre la résignation à la fatalité.
Cette transcendance vécue comme protestation contre le mal et l’injustice est difficilement dissociable d’une expérience du bien, voire d’une bonté fondamentale à la source de la vie, s’exprimant spontanément dans l’art, la gratitude et la louange. Ces expressions sont jointes à l’expérience intime de la beauté du monde et de la vie, en dépit des horreurs, et aux témoignages, au cœur de celles-ci, de petits gestes bouleversants de bonté. Elles sont autant d’épiphanies de cette transcendance, qui soulève l’existence et fait vivre. Même notre univers bétonné, quadrillé et discipliné par les nouvelles technologies et la publicité tentaculaire ne peut se soustraire totalement à cette expérience faisant constamment planer la menace de brèches.
Car la vie est têtue, même aliénée – parce que toujours menacée d’aliénation. La soif et la faim d’une existence digne d’être vécue poussent à rompre l’enchantement, à creuser des puits en soi, en quête de sens comme d’eau vive. Le silence clair-obscur d’une église, la beauté sidérante d’un paysage, ou des traces sacrées de sagesses millénaires peuvent soudainement rappeler la profondeur de la vie et la présence de Dieu, même dans l’autre le plus repoussant, et son appel à l’aide. Ce peut être aussi le murmure ténu de l’Évangile. Il peut insuffler du courage et une autre voie plus vivifiante à qui est exclu de la production effrénée de superflus, ou rechigne à sa cadence ou encore s’y refuse.
À ce surgissement d’élan de vie irrépressible, la Terre même répond par un cri ahurissant – un tollé joint aux cris des pauvres qui se perdent, eux, dans l’indifférence. Mais celui-là réveille de l’illusion entretenue soigneusement par l’idole du Progrès nous empêchant de voir et de ressentir l’effondrement que nous préparons. Le monde et le vivant sont en train de s’effondrer par la démesure babélienne qui nous porte à agir en maîtres et possesseurs de la nature dont il aurait fallu plutôt prendre soin comme de nous-mêmes. Pour avoir rompu avec les liens intimes et vitaux, symboliques et matériels, qui nous unissent à la Terre, notre mère, et à la vie dont nous faisons partie. Pour avoir ainsi abuser d’eux à volonté et sans remords, comme simples objets personnels de jouissance. Pour s’être obstinés à fonder notre manière de vivre, insensée, sur la croissance infinie dans un monde fini, et avoir laissé libre cours à la convoitise et la rapacité humaines. Les sagesses autochtones nous en alertent avec véhémence, réveillant d’autres sources religieuses en renfort, comme celle de la Bible, qui appelle à être les gardiens de la Terre et nos frères et sœurs humains.
Dieu, compagnon d’exode et de combat
En ces temps sombres, Dieu se présente comme force de libération, si du moins il n’est pas prétexte à fuir d’une autre manière le monde, en se réfugiant dans un au-delà anesthésiant, dispensant d’éprouver, dans toute sa profondeur, amplitude et finitude, notre condition humaine. Ou pire encore, en s’érigeant en maîtres, sur les épaules confortables d’un Dieu tout-puissant – une toute-puissance qui n’est pas celle de l’Amour –, pour assouvir sa haine de la vie.
Non, le Dieu dont il est question, ici, est le Dieu de l’Exode, des Évangiles et de l’Apocalypse. Il ne se détourne pas du monde. Il y est engagé depuis que le monde est monde et que l’être humain est en quête d’humanité, du bon, du beau, du juste. Il en est son compagnon de route et de lutte, solidaire depuis Abraham, Moïse, Amos... Celui qui pleure avec les affligés, priant avec les désespérés, mutilé avec les torturés (Mt 5,1-12), solidaire des souffrances comme des espoirs humains. Il est le Dieu qui vit, souffre et meurt en Jésus : l’Agneau égorgé debout (Ap 5,6). Il n’a de cesse d’animer l’espérance et la lutte. De faire entendre sa voix subversives et libératrices à qui a des oreilles pour entendre, lui qui a planté sa tente d’itinérant parmi nous pour animer notre marche sur les sentiers cahoteux et bourbeux de l’existence et en faire un chemin de résistance et de vie. Il le fait en soutenant les mains qui brisent les chaînes quelles qu’elles soient, les bouches qui libèrent la parole, les bras qui enlacent l’éprouvé, la voix qui chante pour enluminer la nuit et le cœur (Lc 4,18-19). Il est dans la parabole du bon Samaritain : à la fois le gisant blessé et anonyme du bord de la route et l’aidant qui le recueille et le soigne (Lc 10,29-37). Il prie en nous... il nous implore d’affronter sans crainte la violence et de la désamorcer, de ne pas rajouter à la haine, mais de la vaincre en lui opposant l’amour, sa force comme sa faiblesse, sa vérité comme son silence, et d’être prêts à souffrir s’il le faut et à donner sa vie. Comme Jésus.
Chercheur associé au Centre justice et foi, Jean-Claude Ravet a été rédacteur en chef de la revue Relations de 2005 à 2019.